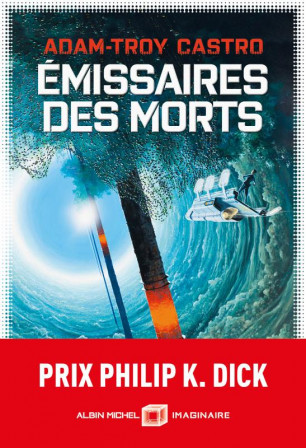 Ce roboratif volume (plus de 700 pages) a été la première incursion en français dans les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à une héroïne particulièrement attachante, Andrea Cort. Composé de quatre longues nouvelles (ou novellas) et du roman éponyme, le projet éditorial permet une entrée fournie dans un monde où les êtres humains, regroupés dans la Confédération homsap, ont essaimé dans l’espace et rencontré d’autres espèces sentientes (dans la mesure où la traduction utilise ce mot, il sera repris ici), établissant au passage des protocoles communs de premier contact et une jurisprudence pointilleuse sur les crimes perpétrés entre espèces. Andrea Cort travaille comme juriste pour le procureur général du Corps diplomatique homsap ; elle a pour mission d’assurer que le traitement des humains liés à des exactions (qu’ils soient victimes ou criminels) sur d’autres mondes est équitable et dans l’intérêt de toutes les parties.
Ce roboratif volume (plus de 700 pages) a été la première incursion en français dans les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à une héroïne particulièrement attachante, Andrea Cort. Composé de quatre longues nouvelles (ou novellas) et du roman éponyme, le projet éditorial permet une entrée fournie dans un monde où les êtres humains, regroupés dans la Confédération homsap, ont essaimé dans l’espace et rencontré d’autres espèces sentientes (dans la mesure où la traduction utilise ce mot, il sera repris ici), établissant au passage des protocoles communs de premier contact et une jurisprudence pointilleuse sur les crimes perpétrés entre espèces. Andrea Cort travaille comme juriste pour le procureur général du Corps diplomatique homsap ; elle a pour mission d’assurer que le traitement des humains liés à des exactions (qu’ils soient victimes ou criminels) sur d’autres mondes est équitable et dans l’intérêt de toutes les parties.
Les quatre premiers textes la montrent à l’œuvre dans différents contextes planétaires. Envoyée chez les Zinns, dont la population frôle la limite de l’extinction et qui ne peuvent concevoir une quelconque forme de violence, elle doit valider leur demande de donner asile à un criminel humain en échange d’une technologie avancée de propulsion spatiale. Sur Caithiriin, elle reçoit pour mission de superviser l’exécution d’un autre criminel humain, pour s’apercevoir que les Caiths condamnés, eux, bénéficient d’un choix alternatif à la traditionnelle mise à mort longue et terrifiante. On la voit également mener un interrogatoire sur La Nouvelle-Londres, le monde-cylindre sur lequel elle est basée, afin de confondre un agresseur parmi deux suspects. Et puis, dans la dernière courte enquête, c’est au principe même du premier contact qu’elle se heurte : un employé du Corps diplomatique a torturé et tué des Catarkhiens, considérés comme sentients, mais qui semblent ignorer toutes les interactions avec les différentes espèces qui se sont posées sur leur monde. Un tribunal catarkhien, dès lors, est-il possible, et comment juger le meurtrier ?
On le voit, la science-fiction d’Adam-Troy Castro dans cette série est influencée tant par les aspects juridiques que par la notion de différence entre espèces qui engendre, au mieux, l’incompréhension. Non pas que ces histoires ne comportent pas d’action (ou de psychologie — nous allons y revenir), mais elles dégagent comme un goût de film de prétoire ma foi pas désagréable. Le style renforce cette impression, utilisant des techniques de narration très cinématographiques (courtes scènes, retours en arrière, explications a posteriori sur des images déjà vues…), jusqu’à une plaidoirie en bonne et due forme. Un style d’abord efficace et sobre, servi par une traduction fluide : on ne lit pas les aventures d’Andrea Cort pour admirer la virtuosité ou l’invention langagière de son auteur. Mais on se laisse emporter, surtout grâce à la psychologie développée de l’héroïne.
Parce que, il faut bien le dire, Andrea Cort est fascinante. En premier lieu, c’est une meurtrière… et ce depuis l’âge de huit ans déjà, dans un épisode évoqué plusieurs fois et expliqué par petites touches au fil des nouvelles. C’est grâce à ce traumatisme suivi d’une incarcération que le Corps diplomatique la tient et utilise son intelligence vive pour résoudre des problèmes nécessairement compliqués entre espèces sentientes — au cours de ses enquêtes, elle parvient à mettre au jour des aspects soigneusement dissimulés ou auxquels personne n’a encore pensé. La juriste, d’autre part, n’a pas une haute opinion d’elle-même, se considérant comme un monstre, à l’image des criminels qu’elle rencontre. Elle fait aussi preuve d’un cynisme à toute épreuve, comme lorsqu’elle souhaite à une collaboratrice locale la « bienvenue au sein de l’immense farce connue sous le nom de diplomatie interespèces ». Bref, une antihéroïne qu’on adore détester et admirer à la fois, qui mérite le qualificatif de garce utilisé de façon récurrente pour désigner la nature de ses relations avec ses collègues tout en éprouvant pour certaines personnes une « profonde empathie ». Et qui, selon plusieurs rapports concordants, montre une intégrité inébranlable. Les contradictions du personnage instillent ce qu’il faut de tension aux récits, dont certains peuvent paraître prévisibles, pour que le plaisir de lecture soit là et bien là.
Outre cet apport psychologique intéressant concernant la protagoniste, Adam-Troy Castro sait aussi distiller peu à peu les indications sur le monde futur qu’il décrit. On pourrait essayer de dater celui-ci et de le soumettre à une fine analyse de cohérence ; pour ma part, j’ai apprécié le fait que ces informations soient en marge mais bien présentes. On apprend au détour de quelques phrases qu’on peut changer son apparence à l’envi, en particulier. Raison de plus pour Andrea Cort d’arborer une éternelle coupe de cheveux au carré avec juste une longue mèche et de porter en permanence un strict ensemble noir. Quant aux descriptions liées à l’exobiologie, elles sont suffisamment détaillées pour susciter la curiosité sans pour autant devenir fastidieuses. Tout est question de dosage, et l’auteur maîtrise les poids et les mesures sur cet aspect. « Comme la plupart du temps, avec les extraterrestres, toute ressemblance avec un [geste] équivalent humain relevait au mieux de la coïncidence » : pourtant, c’est de nous et de notre époque que parle Castro, en remuant dans le chaudron science-fictif les bas instincts de notre espèce, vus à travers les yeux (ou équivalents !) d’autres sentients et d’une juriste plutôt asociale. Comment pourrait-il en être autrement, quand la langue commune qu’utilisent les diverses ambassades se nomme le « mercantile » ?
Dans le roman proposé en plat de résistance, Andrea Cort est envoyée sur Un Un Un, un monde-cylindre de dimensions gigantesques à des années-lumière de toute vie. Les IAs-source, dont on ne connaît pas l’ancrage physique et qui se matérialisent parfois sur des écrans flottants à des fins de diplomatie, y ont créé leur propre espèce sentiente, violant a priori les principes interespèces qui bannissent l’esclavage. La délégation humaine, seule à avoir obtenu un droit d’observation sur cette colonie très particulière, s’est vu amputer de deux personnes tuées dans des conditions suspectes. L’enquête ne sera pas de tout repos pour notre héroïne : atteinte de vertige, elle devra évoluer en permanence dans les « hauteurs » d’Un Un Un (la notion de haut et de bas est relative dans un monde-cylindre), seul endroit vivable. En « bas », un océan acide bouillonnant. Sa hiérarchie lui a de plus donné des instructions claires : elle doit à tout prix innocenter les puissantes IAs-source, officiellement bienfaitrices des autres espèces. De là à accuser leur création, les Brachiens, sorte de paresseux intelligents qui voient les humains comme des morts (d’où le titre), il n’y a qu’un pas que Cort, obstinée, se refusera de franchir aussi facilement.
Si l’on a lu les quatre nouvelles qui précèdent, présentées dans l’ordre chronologique pour l’héroïne, on trouvera un certain nombre de redites dans le roman. L’intérêt de parcourir ces textes avant est tout de même réel, puisqu’il permet d’y arriver avec un bagage lié à la psychologie d’Andrea Cort. Ainsi, on connaîtra déjà l’épiphanie qui lui a fait découvrir le concept de « démons invisibles », à l’œuvre dans le fameux épisode meurtrier de son enfance sur la planète Bocai. D’une manière générale, Adam-Troy Castro semble plus à l’aise avec les formes courtes, certaines descriptions ou conversations se prolongeant ici un peu trop ou faisant preuve d’un didactisme appuyé — sensation très présente notamment lorsque les fils de l’intrigue se dénouent. On a parfois l’impression que l’auteur a envie de démontrer qu’il est un créateur d’univers et dans le même temps maîtrise les codes du whodunit. Que ledit univers soit inspiré en partie d’autres déjà publiés peut constituer une querelle de spécialistes de la science-fiction, mais le monde-cylindre d’Un Un Un se tient de façon correcte, même si les explications ne foisonnent pas. La virtuosité d’écriture cinématographique susmentionnée est à son comble dans deux belles (enfin, belles…) scènes : la dislocation du hamac d’Andrea Cort et ses acrobaties périlleuses pour échapper à la chute mortelle, ainsi que le retour en arrière très réaliste sur le meurtre qui la hante depuis l’enfance. Mais on ne peut s’empêcher non plus de trouver les IAs-source bien cachottières pour des entités quasi toutes-puissantes, ne révélant des informations essentielles à la juriste qu’après maintes péripéties, en avançant des arguments politiques alambiqués et pas vraiment convaincants. Un moyen, encore une fois, de tirer le récit en longueur ?
On le voit, le roman manque un peu du punch des nouvelles. Comme celles-ci, cependant, il bénéficie de l’intérêt que suscite le personnage d’Andrea Cort, sur le chemin de l’acceptation de son passé. C’est au fond moins la résolution de l’enquête qui importe que ce qu’elle apporte de réponses dans la quête personnelle de l’héroïne, posant des fondations intelligentes pour les volumes à venir (le deuxième a déjà paru, le troisième arrive). Ajoutons que les réflexions sur les notions de libre arbitre ou d’esclavagisme permettent de dépasser le cadre d’une enquête policière façon space opera de pur divertissement. À la fin, la balance entre fascination et détestation de cette juriste à la volonté de fer, parvenue à s’affranchir d’une partie de sa misanthropie, penche clairement en faveur de la fascination. L’univers n’est pas figé, après tout.
Adam-Troy Castro, Émissaires des morts, traduction de Benoît Domis, Albin Michel Imaginaire, ISBN 9782226443700
Cette note de lecture a été réalisée après un service de presse d’Albin Michel Imaginaire, que je remercie.
Dans la blogosphère des littératures de l’imaginaire, les autres critiques sont souvent mentionnées par des liens. Peut-être viendrai-je à cette pratique, mais, pour l’instant, je voudrais seulement mentionner celle d’Apophis pour approfondir les similitudes d’univers ; on y trouve cependant à la fin, dans la rubrique « Pour aller plus loin », des liens vers d’autres sites qui ont évoqué le livre.
 Nous sommes au xviie siècle, en Chine. La jeune Chen, en voyage avec son père – un lettré qui a exercé de hautes fonctions –, s’égare dans une foire et se voit remettre par un mystérieux boutiquier un bracelet de jade. Celui-ci va bientôt la fasciner, au point qu’elle en fera des rêves déroutants. Ce sont les conversations avec son père qui lui permettront de percer le secret du bijou, lequel lui ouvrira des portes insoupçonnées sur la compréhension du monde dans lequel elle vit. Un monde marqué par les turbulences des luttes de pouvoir, et dont elle est miraculeusement protégée par le travail que son géniteur accomplit pour façonner son jardin.
Nous sommes au xviie siècle, en Chine. La jeune Chen, en voyage avec son père – un lettré qui a exercé de hautes fonctions –, s’égare dans une foire et se voit remettre par un mystérieux boutiquier un bracelet de jade. Celui-ci va bientôt la fasciner, au point qu’elle en fera des rêves déroutants. Ce sont les conversations avec son père qui lui permettront de percer le secret du bijou, lequel lui ouvrira des portes insoupçonnées sur la compréhension du monde dans lequel elle vit. Un monde marqué par les turbulences des luttes de pouvoir, et dont elle est miraculeusement protégée par le travail que son géniteur accomplit pour façonner son jardin.
 [Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]
[Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.] [Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]
[Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.] C’est sous la forme d’un recueil de nouvelles que Laurent Genefort
C’est sous la forme d’un recueil de nouvelles que Laurent Genefort 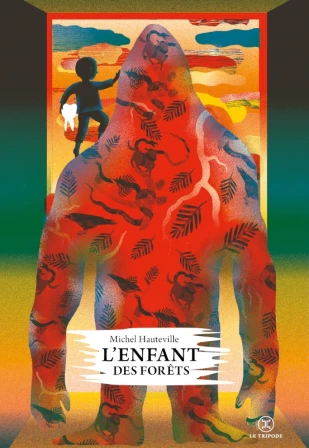 [Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]
[Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.] [Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]
[Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]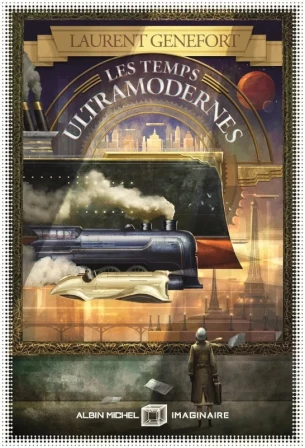 [Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois, cet article en particulier étant destiné à être lié à un prochain sur ce site qui sera consacré à La Croisière bleue, la nouvelle incursion de Laurent Genefort dans les temps ultramodernes. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]
[Je reproduis ici, passé un certain délai, mes articles consacrés à des livres relevant des littératures de l’imaginaire pour le supplément Livres-Bücher du Tageblatt luxembourgeois, cet article en particulier étant destiné à être lié à un prochain sur ce site qui sera consacré à La Croisière bleue, la nouvelle incursion de Laurent Genefort dans les temps ultramodernes. Limités en signes, ces articles sont formatés pour un journal imprimé, mais celui-ci ne les publie pas en ligne.]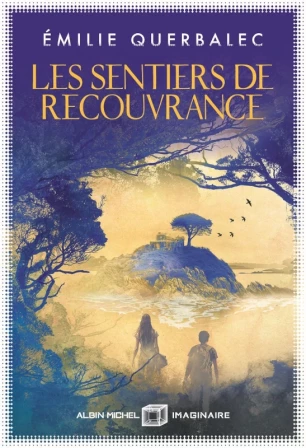
 « C’est peut-être en atteignant un état stable, relativement protégé du danger, que nos ancêtres ont commencé à sentir palpiter en eux une vie nocturne. Les rêves auraient pris racine dans la chaleur et la sécurité de leurs premiers abris, dans le repos tranquille de celui qui chasse plutôt qu’il est chassé. / C’est dans le confort que naissent les films catastrophe. / L’être humain de notre temps, malgré toutes ses victoires, continue de craindre les animaux féroces. » Entre nouvelles, bribes de roman, poèmes en prose ou descriptions oniriques, ce stimulant petit livre d’une jeune autrice québécoise navigue dans un genre littéraire aussi indéfini que le lieu dans lequel il se passe. Certes, on apprendra que l’action se déroule à Shivering Heights (de Shivering à Wuthering, l’hommage est palpable), un endroit où le lac est infesté de requins — il vaut mieux, d’ailleurs, ne pas s’y baigner la nuit. Certes, la biologiste Laura s’invite en protagoniste dans la plupart des courts récits qui composent l’ouvrage. Mais les personnages humains au premier abord réservent des surprises : « Sa nageoire dorsale brille d’un éclat mordoré sous les rayons de la lune tandis qu’il s’éloigne. » C’est leur complexité psychologique autant que physique, au demeurant, qui fait qu’on les chérit à la lecture, telle Laura justement, à l’attitude hésitante lorsqu’il s’agit de sauver une personne qui s’est littéralement jetée dans la fosse aux lions. Ici, pas question de différence entre humanité et animalité. Les frontières du vivant s’estompent, même si un « géant barbu », qui jette des sacs d’ordures au fond du lac, rappelle à qui la catastrophe de la sixième extinction massive est à imputer. Dans ce monde revivent peut-être même les sorcières, grouillent les chamanes, qui communient avec la nature par le ventre : « Sur son passage, Heather n’épargne aucune fleur. Aucun champignon. Pleurotus ostreatus. Hydnum repandum. Une mouche, tournoyant dans son parfum, finit par se poser sur son épaule : elle la saisit d’un geste vif, puis la dévore. Tout ce qu’elle trouve, elle le grappille et l’enfonce dans sa bouche, sa toute petite bouche, d’une envergure à peine suffisante pour y laisser couler l’albumen d’un œuf d’oiseau. Lorsque l’odeur piquante d’une plante lui rappelle celle d’un corps en sueur, elle l’arrache pour en engloutir les racines encore souillées d’un humus noir. » Il faut se plonger dans Faunes pour faire l’expérience du vertige que l’autrice sait provoquer en nous. Conciliant dans sa prose l’harmonie entre les espèces et le désordre anthropique, le livre a la puissance concise d’un recueil de poésie et le foisonnement créatif d’un roman fleuve. Du grand art.
« C’est peut-être en atteignant un état stable, relativement protégé du danger, que nos ancêtres ont commencé à sentir palpiter en eux une vie nocturne. Les rêves auraient pris racine dans la chaleur et la sécurité de leurs premiers abris, dans le repos tranquille de celui qui chasse plutôt qu’il est chassé. / C’est dans le confort que naissent les films catastrophe. / L’être humain de notre temps, malgré toutes ses victoires, continue de craindre les animaux féroces. » Entre nouvelles, bribes de roman, poèmes en prose ou descriptions oniriques, ce stimulant petit livre d’une jeune autrice québécoise navigue dans un genre littéraire aussi indéfini que le lieu dans lequel il se passe. Certes, on apprendra que l’action se déroule à Shivering Heights (de Shivering à Wuthering, l’hommage est palpable), un endroit où le lac est infesté de requins — il vaut mieux, d’ailleurs, ne pas s’y baigner la nuit. Certes, la biologiste Laura s’invite en protagoniste dans la plupart des courts récits qui composent l’ouvrage. Mais les personnages humains au premier abord réservent des surprises : « Sa nageoire dorsale brille d’un éclat mordoré sous les rayons de la lune tandis qu’il s’éloigne. » C’est leur complexité psychologique autant que physique, au demeurant, qui fait qu’on les chérit à la lecture, telle Laura justement, à l’attitude hésitante lorsqu’il s’agit de sauver une personne qui s’est littéralement jetée dans la fosse aux lions. Ici, pas question de différence entre humanité et animalité. Les frontières du vivant s’estompent, même si un « géant barbu », qui jette des sacs d’ordures au fond du lac, rappelle à qui la catastrophe de la sixième extinction massive est à imputer. Dans ce monde revivent peut-être même les sorcières, grouillent les chamanes, qui communient avec la nature par le ventre : « Sur son passage, Heather n’épargne aucune fleur. Aucun champignon. Pleurotus ostreatus. Hydnum repandum. Une mouche, tournoyant dans son parfum, finit par se poser sur son épaule : elle la saisit d’un geste vif, puis la dévore. Tout ce qu’elle trouve, elle le grappille et l’enfonce dans sa bouche, sa toute petite bouche, d’une envergure à peine suffisante pour y laisser couler l’albumen d’un œuf d’oiseau. Lorsque l’odeur piquante d’une plante lui rappelle celle d’un corps en sueur, elle l’arrache pour en engloutir les racines encore souillées d’un humus noir. » Il faut se plonger dans Faunes pour faire l’expérience du vertige que l’autrice sait provoquer en nous. Conciliant dans sa prose l’harmonie entre les espèces et le désordre anthropique, le livre a la puissance concise d’un recueil de poésie et le foisonnement créatif d’un roman fleuve. Du grand art.
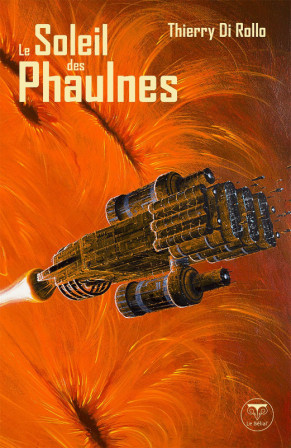 Gobo est une sorte de paradis… extraterrestre, où sous les rayons du soleil Titéo vivent les Phaulnes en harmonie avec leur environnement. Ces humanoïdes « ont pour principe de ne jamais tuer un animal. Nous prélevons ceux qui se préparent à mourir parce que trop vieux ou condamnés par la maladie ou la faim. Le reste du temps, on chasse à l’assommoir. Nous traquons une bête, pour le seul plaisir que cela procure et en ne perdant jamais de vue le respect que l’on doit avoir pour elle, puis nous la visons d’une flèche étourdissante, et, à son réveil, nous la rendons à la forêt » : ainsi s’exprime Griddine, fière indigène de cette planète, que va bientôt bouleverser la nouvelle de l’exploitation de son soleil par la toute-puissante multimonde Garmak, dirigée par le « yotta-octillionnaire » (l’auteur précise en note que cela représente 1024 × 1048 unités, tout de même) Ien Éliki. Unique solution pour les Phaulnes, bénéficier de l’évacuation prévue par l’entreprise vampire et constituer une diaspora sur une étendue incommensurable de systèmes planétaires. Car résister n’est pas envisageable : ils ont fait le choix d’arrêter leur progrès à l’arc et aux flèches, chevauchant hardiment leurs war-lizzards, alors que la Garmak dispose d’une technologie indiscernable de la magie. Résister, peut-être pas, mais aller dire à Éliki ses quatre vérités, c’est ce que veut faire la pugnace Griddine.
Gobo est une sorte de paradis… extraterrestre, où sous les rayons du soleil Titéo vivent les Phaulnes en harmonie avec leur environnement. Ces humanoïdes « ont pour principe de ne jamais tuer un animal. Nous prélevons ceux qui se préparent à mourir parce que trop vieux ou condamnés par la maladie ou la faim. Le reste du temps, on chasse à l’assommoir. Nous traquons une bête, pour le seul plaisir que cela procure et en ne perdant jamais de vue le respect que l’on doit avoir pour elle, puis nous la visons d’une flèche étourdissante, et, à son réveil, nous la rendons à la forêt » : ainsi s’exprime Griddine, fière indigène de cette planète, que va bientôt bouleverser la nouvelle de l’exploitation de son soleil par la toute-puissante multimonde Garmak, dirigée par le « yotta-octillionnaire » (l’auteur précise en note que cela représente 1024 × 1048 unités, tout de même) Ien Éliki. Unique solution pour les Phaulnes, bénéficier de l’évacuation prévue par l’entreprise vampire et constituer une diaspora sur une étendue incommensurable de systèmes planétaires. Car résister n’est pas envisageable : ils ont fait le choix d’arrêter leur progrès à l’arc et aux flèches, chevauchant hardiment leurs war-lizzards, alors que la Garmak dispose d’une technologie indiscernable de la magie. Résister, peut-être pas, mais aller dire à Éliki ses quatre vérités, c’est ce que veut faire la pugnace Griddine. « L’histoire n’est jamais figée, il suffit d’en changer les mots pour en fonder une nouvelle. » Cette phrase que Jean-Laurent Del Socorro fait écrire à Arthur est peut-être ce que l’on pourrait appeler l’art poétique de Morgane Pendragon. Car l’intention est claire : à travers cette figure de reine de Logres, l’auteur entend redonner aux femmes une place aussi importante que celle des hommes dans la légende arthurienne… pardon, morganienne ! À cet effet, il introduit un point de divergence (entre autres inversions ou changements de personnages) où Morgane plutôt qu’Arthur retire l’épée solidement fichée qui lui permet d’accéder au trône. Arthur, dans le roman, est relégué au rôle d’amant de celle-ci, partagé entre amour et sentiment de n’avoir pas accompli son destin — lui qui pourtant était le champion de Merlin. La dynamique du livre se répartit ainsi entre le malheureux et Morgane ; les deux content à la première personne ce récit de chevalerie, de magie et de politique.
« L’histoire n’est jamais figée, il suffit d’en changer les mots pour en fonder une nouvelle. » Cette phrase que Jean-Laurent Del Socorro fait écrire à Arthur est peut-être ce que l’on pourrait appeler l’art poétique de Morgane Pendragon. Car l’intention est claire : à travers cette figure de reine de Logres, l’auteur entend redonner aux femmes une place aussi importante que celle des hommes dans la légende arthurienne… pardon, morganienne ! À cet effet, il introduit un point de divergence (entre autres inversions ou changements de personnages) où Morgane plutôt qu’Arthur retire l’épée solidement fichée qui lui permet d’accéder au trône. Arthur, dans le roman, est relégué au rôle d’amant de celle-ci, partagé entre amour et sentiment de n’avoir pas accompli son destin — lui qui pourtant était le champion de Merlin. La dynamique du livre se répartit ainsi entre le malheureux et Morgane ; les deux content à la première personne ce récit de chevalerie, de magie et de politique. Les éditions Albin Michel Imaginaire ont pris la (bonne) habitude de précéder la sortie de nombre de nouveaux livres par une nouvelle de l’auteur ou autrice concernée en version numérique gratuite. C’est dans ce cadre que sortira, le 30 décembre, Noir est le sceau de l’enfer, de Jean-Laurent Del Socorro, avant que le 18 janvier paraisse Morgane Pendragon. Avant donc une chronique sur celui-ci, parlons de celui-là, d’autant que, à cette époque de l’année, un cadeau ne se refuse pas.
Les éditions Albin Michel Imaginaire ont pris la (bonne) habitude de précéder la sortie de nombre de nouveaux livres par une nouvelle de l’auteur ou autrice concernée en version numérique gratuite. C’est dans ce cadre que sortira, le 30 décembre, Noir est le sceau de l’enfer, de Jean-Laurent Del Socorro, avant que le 18 janvier paraisse Morgane Pendragon. Avant donc une chronique sur celui-ci, parlons de celui-là, d’autant que, à cette époque de l’année, un cadeau ne se refuse pas. Et si les propriétés étonnantes de l’intrication quantique, laquelle lie définitivement et où qu’ils se trouvent dans l’univers deux photons ayant interagi, s’invitaient dans notre monde bien réglé ? Dans Le Temps des Grêlons, ce sont soudain les appareils photo qui ne fonctionnent plus : nature et paysages impriment les capteurs, mais les humains restent désespérément absents des clichés. On imagine les conséquences… parmi lesquelles la nécessité de présenter des dessins à l’antenne du journal télévisé ! Le narrateur du roman (dont le prénom ne sera révélé qu’à la fin), Jean-Jean et Gwendo, à Apt, doivent vivre leur adolescence avec ce phénomène inexpliqué, mais bien là pour durer.
Et si les propriétés étonnantes de l’intrication quantique, laquelle lie définitivement et où qu’ils se trouvent dans l’univers deux photons ayant interagi, s’invitaient dans notre monde bien réglé ? Dans Le Temps des Grêlons, ce sont soudain les appareils photo qui ne fonctionnent plus : nature et paysages impriment les capteurs, mais les humains restent désespérément absents des clichés. On imagine les conséquences… parmi lesquelles la nécessité de présenter des dessins à l’antenne du journal télévisé ! Le narrateur du roman (dont le prénom ne sera révélé qu’à la fin), Jean-Jean et Gwendo, à Apt, doivent vivre leur adolescence avec ce phénomène inexpliqué, mais bien là pour durer.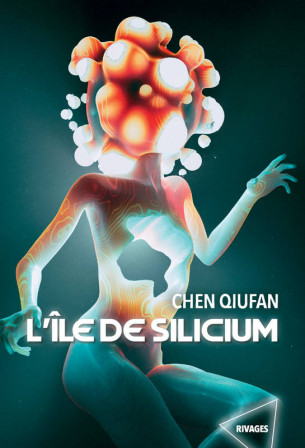 « De nos jours […], les riches changent de membres aussi facilement que de téléphone. Les prothèses hors d’usage sont envoyées ici, certaines n’ont même pas été stérilisées et contiennent encore du sang ou des fluides corporels, ce qui, vous l’imaginez, présente de grands risques en matière de gestion sanitaire. » Ici, c’est au large des côtes chinoises du Guangdong, sur l’île de Silicium, sorte de paradis du recyclage des déchets — occidentaux surtout — tenu par des familles rivales qui exploitent les « déchetiers ». Ceux-ci sont des migrants intérieurs chinois qui viennent y trouver du travail… mais aussi des conditions de vie peu enviables. De surcroît, à l’ère du tout-connecté, l’endroit a été décrété par les autorités centrales « zone à débit restreint », à la suite d’une sanction administrative. Exit donc la réalité augmentée omniprésente ailleurs. S’en est ensuivi un exode de la population locale, remplacée dès lors par des migrants d’autres provinces : « À une époque où la vitesse de l’information déterminait tout, un débit limité signifiait une absence de valeur, d’opportunité et d’avenir. » Si le monde décrit par Chen Qiufan est imaginaire — quoiqu’inspiré de sa propre origine —, il est très marqué par la méfiance envers l’autre lorsqu’il ne vient pas du même endroit, la migration économique forcée ainsi que la pulsion d’exploitation des pauvres par les riches. Autant dire qu’on n’a pas de mal à s’y insérer par la lecture tant l’anticipation y paraît crédible.
« De nos jours […], les riches changent de membres aussi facilement que de téléphone. Les prothèses hors d’usage sont envoyées ici, certaines n’ont même pas été stérilisées et contiennent encore du sang ou des fluides corporels, ce qui, vous l’imaginez, présente de grands risques en matière de gestion sanitaire. » Ici, c’est au large des côtes chinoises du Guangdong, sur l’île de Silicium, sorte de paradis du recyclage des déchets — occidentaux surtout — tenu par des familles rivales qui exploitent les « déchetiers ». Ceux-ci sont des migrants intérieurs chinois qui viennent y trouver du travail… mais aussi des conditions de vie peu enviables. De surcroît, à l’ère du tout-connecté, l’endroit a été décrété par les autorités centrales « zone à débit restreint », à la suite d’une sanction administrative. Exit donc la réalité augmentée omniprésente ailleurs. S’en est ensuivi un exode de la population locale, remplacée dès lors par des migrants d’autres provinces : « À une époque où la vitesse de l’information déterminait tout, un débit limité signifiait une absence de valeur, d’opportunité et d’avenir. » Si le monde décrit par Chen Qiufan est imaginaire — quoiqu’inspiré de sa propre origine —, il est très marqué par la méfiance envers l’autre lorsqu’il ne vient pas du même endroit, la migration économique forcée ainsi que la pulsion d’exploitation des pauvres par les riches. Autant dire qu’on n’a pas de mal à s’y insérer par la lecture tant l’anticipation y paraît crédible. On pourrait dire de Marguerite Imbert qu’elle s’essaie aux littératures de l’imaginaire après être passée par la littérature blanche. Mais cette romancière née en 1994 n’a publié qu’un livre — consacré à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes — chez Albin Michel avant de sortir chez la branche imaginaire du même éditeur, le 28 septembre dernier, Les Flibustiers de la mer chimique. De plus, contrairement au monde post-apocalyptique de Laurent Gaudé, transfuge de genre dont
On pourrait dire de Marguerite Imbert qu’elle s’essaie aux littératures de l’imaginaire après être passée par la littérature blanche. Mais cette romancière née en 1994 n’a publié qu’un livre — consacré à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes — chez Albin Michel avant de sortir chez la branche imaginaire du même éditeur, le 28 septembre dernier, Les Flibustiers de la mer chimique. De plus, contrairement au monde post-apocalyptique de Laurent Gaudé, transfuge de genre dont  Quand un ex-récipiendaire du prix Goncourt et romancier à succès se lance dans un livre relevant des littératures de l’imaginaire, forcément, la curiosité des enthousiastes du genre est piquée. C’est ainsi que s’est trouvé entre mes mains Chien 51, fiction d’anticipation dystopique de Laurent Gaudé, mâtinée de polar. Enfin… peut-être plus polar qu’imaginaire, au fond. Mais nous y reviendrons. Toujours est-il que le roman plante un décor d’avenir pas particulièrement réjouissant : devant l’accumulation des faillites d’États, des multinationales aux poches bien remplies ont décidé de franchir le pas et de s’offrir des pays. C’est la Grèce qui a ouvert le bal, et ses habitants sont devenus à la finalisation de son rachat par GoldTex des « cilariés », un mot-valise composé de « citoyen » et de « salarié », puisque dans ce monde comme dans le nôtre, le lavage de cerveau passe par un vocabulaire savamment étudié. La firme n’a pas lésiné sur les violences pour réprimer les émeutes des contestataires, installant par la suite une véritable dictature entrepreneuriale plutôt qu’étatique.
Quand un ex-récipiendaire du prix Goncourt et romancier à succès se lance dans un livre relevant des littératures de l’imaginaire, forcément, la curiosité des enthousiastes du genre est piquée. C’est ainsi que s’est trouvé entre mes mains Chien 51, fiction d’anticipation dystopique de Laurent Gaudé, mâtinée de polar. Enfin… peut-être plus polar qu’imaginaire, au fond. Mais nous y reviendrons. Toujours est-il que le roman plante un décor d’avenir pas particulièrement réjouissant : devant l’accumulation des faillites d’États, des multinationales aux poches bien remplies ont décidé de franchir le pas et de s’offrir des pays. C’est la Grèce qui a ouvert le bal, et ses habitants sont devenus à la finalisation de son rachat par GoldTex des « cilariés », un mot-valise composé de « citoyen » et de « salarié », puisque dans ce monde comme dans le nôtre, le lavage de cerveau passe par un vocabulaire savamment étudié. La firme n’a pas lésiné sur les violences pour réprimer les émeutes des contestataires, installant par la suite une véritable dictature entrepreneuriale plutôt qu’étatique.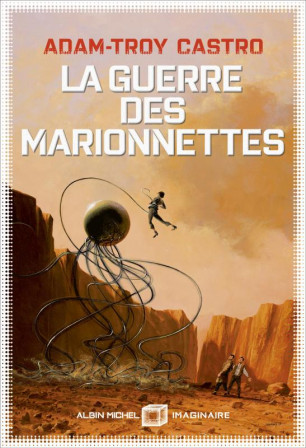 Pour ce tome final des tribulations d’Andrea Cort, les éditions Albin Michel Imaginaire ont à nouveau opté pour un format où la pièce de résistance du roman est accompagnée de textes plus courts, achevant ainsi la publication en français de tous les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à la garce psychorigide et cabossée qu’on a découverte dans
Pour ce tome final des tribulations d’Andrea Cort, les éditions Albin Michel Imaginaire ont à nouveau opté pour un format où la pièce de résistance du roman est accompagnée de textes plus courts, achevant ainsi la publication en français de tous les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à la garce psychorigide et cabossée qu’on a découverte dans 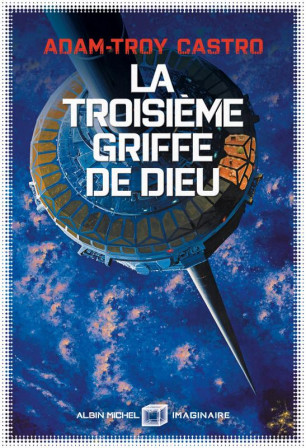 Si l’on mesure l’habileté d’un romancier à créer un personnage récurrent attachant, Adam-Troy Castro est un romancier tout ce qu’il y a de plus habile. Difficile de ne pas avoir envie, après lecture d’
Si l’on mesure l’habileté d’un romancier à créer un personnage récurrent attachant, Adam-Troy Castro est un romancier tout ce qu’il y a de plus habile. Difficile de ne pas avoir envie, après lecture d’
 « Ainsi commença le voyage du petit Malou et du vieux Foladj. Aventure qui ne bouleversa d’autres destins que les leurs, n’entraîna aucune guerre ou révolution, ne fut même pas exemple de sagesse ou de piété, pas plus que source d’embarras ou d’indignation. Aventure qui ne concerna que ces deux-là, fut pour eux d’un prix élevé, leur apporta une grâce qu’on ne trouve dans la plupart des âmes qu’en miettes et en souillures. » Lorsqu’on lit ces lignes dès le premier chapitre, on sait déjà que nous seront épargnées les guerres, les intrigues politiques, la violence. Pourquoi ces dernières seraient-elles des ingrédients obligés de la fantasy, après tout ? Ouvrir Je suis le rêve des autres, c’est se plonger en moins de deux cents pages dans le voyage initiatique de Malou et Foladj. C’est se poser dans un univers où par petites touches Christian Chavassieux convoque des animaux étranges, comme ce lanquedin qui porte nos héros au début de leur périple. Les êtres humains ont eu de mystérieux prédécesseurs, les Almastys, lorsque le continent unique, la Pangée, ne s’était pas encore formé. Violence pourtant : les frères humains — car ici, les oiseaux sont les frères de l’air, les poissons, les frères de l’eau, les créatures terrestres, les frères de terre — les ont massacrés. Mais c’était il y a tellement longtemps… La fraternité semble l’avoir emporté, effectivement. Et puis, à côté des caravanes qui cheminent, les « entrains » (on reconnaît des trains) filent à toute vitesse, les bateaux à voile côtoient les vapeurs sur le fleuve. Un télescopage qui n’est pas sans rappeler celui à l’œuvre dans le Cycle des contrées de Jacques Abeille. D’ailleurs, le style de Christian Chavassieux, onirique, parfois chamanique, en demi-teinte maligne, accentue cette impression — même si les scènes érotiques chères à Abeille sont absentes ici !
« Ainsi commença le voyage du petit Malou et du vieux Foladj. Aventure qui ne bouleversa d’autres destins que les leurs, n’entraîna aucune guerre ou révolution, ne fut même pas exemple de sagesse ou de piété, pas plus que source d’embarras ou d’indignation. Aventure qui ne concerna que ces deux-là, fut pour eux d’un prix élevé, leur apporta une grâce qu’on ne trouve dans la plupart des âmes qu’en miettes et en souillures. » Lorsqu’on lit ces lignes dès le premier chapitre, on sait déjà que nous seront épargnées les guerres, les intrigues politiques, la violence. Pourquoi ces dernières seraient-elles des ingrédients obligés de la fantasy, après tout ? Ouvrir Je suis le rêve des autres, c’est se plonger en moins de deux cents pages dans le voyage initiatique de Malou et Foladj. C’est se poser dans un univers où par petites touches Christian Chavassieux convoque des animaux étranges, comme ce lanquedin qui porte nos héros au début de leur périple. Les êtres humains ont eu de mystérieux prédécesseurs, les Almastys, lorsque le continent unique, la Pangée, ne s’était pas encore formé. Violence pourtant : les frères humains — car ici, les oiseaux sont les frères de l’air, les poissons, les frères de l’eau, les créatures terrestres, les frères de terre — les ont massacrés. Mais c’était il y a tellement longtemps… La fraternité semble l’avoir emporté, effectivement. Et puis, à côté des caravanes qui cheminent, les « entrains » (on reconnaît des trains) filent à toute vitesse, les bateaux à voile côtoient les vapeurs sur le fleuve. Un télescopage qui n’est pas sans rappeler celui à l’œuvre dans le Cycle des contrées de Jacques Abeille. D’ailleurs, le style de Christian Chavassieux, onirique, parfois chamanique, en demi-teinte maligne, accentue cette impression — même si les scènes érotiques chères à Abeille sont absentes ici !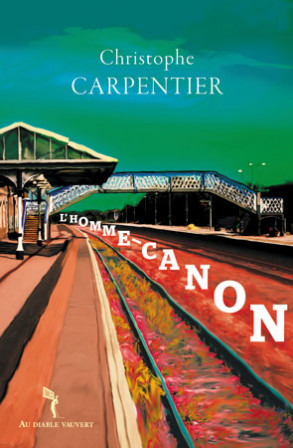 Les Lois de 2057 ont consacré la « psychologie positive » et instauré un « remboursement de la dette sanitaire » consécutif aux pandémies de covid de 2019 et 2052. Un couvre-feu planétaire permanent sévit à dix-neuf heures. Livres, films ou pièces de théâtre ont disparu : ces éhontés « supports fictionnels » ont été remplacés par d’incessants directs télévisés auxquels la population est priée d’assister à longueur de journée, puis d’en discuter la pertinence et l’utilité incontestable. On peut voir ainsi des accouchements en direct, des interventions de la milice, la désincarcération de personnes accidentées, des pêcheurs de l’extrême… Dans le futur ahurissant de L’Homme-canon, « on fabrique aussi du camembert AOC en Mongolie orientale, et le groupe LVMH a acheté des terrains sur la Lune pour y faire pousser des vignes sous serre ». Bref, exit la « rumination introspective » liée au passé, place à l’avenir radieux et au bonheur décrété par l’empathie télévisuelle, « un acte citoyen à part entière ».
Les Lois de 2057 ont consacré la « psychologie positive » et instauré un « remboursement de la dette sanitaire » consécutif aux pandémies de covid de 2019 et 2052. Un couvre-feu planétaire permanent sévit à dix-neuf heures. Livres, films ou pièces de théâtre ont disparu : ces éhontés « supports fictionnels » ont été remplacés par d’incessants directs télévisés auxquels la population est priée d’assister à longueur de journée, puis d’en discuter la pertinence et l’utilité incontestable. On peut voir ainsi des accouchements en direct, des interventions de la milice, la désincarcération de personnes accidentées, des pêcheurs de l’extrême… Dans le futur ahurissant de L’Homme-canon, « on fabrique aussi du camembert AOC en Mongolie orientale, et le groupe LVMH a acheté des terrains sur la Lune pour y faire pousser des vignes sous serre ». Bref, exit la « rumination introspective » liée au passé, place à l’avenir radieux et au bonheur décrété par l’empathie télévisuelle, « un acte citoyen à part entière ».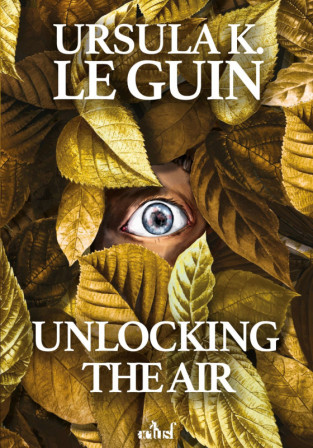 D’habitude, je lis Ursula K. Le Guin en anglais. Mais l’occasion était trop bonne, pour ce recueil que je n’avais pas encore, de bénéficier d’une promotion numérique attractive des éditions ActuSF (désolé, elle est terminée au moment où j’écris). C’est donc en français que j’ai parcouru les dix-huit nouvelles qui composent l’ouvrage. Avec une petite impression étrange de ne pas toujours percevoir la fluidité et la clarté de l’autrice dans sa langue d’écriture ; mais je ne saurais dire si cela est dû aux traductions d’Erwan Devos et Hermine Hémon, puisque je n’ai pas consulté la version originale. Il est vrai aussi que les textes de ce recueil sont particulièrement exigeants, par leur style parfois, mais surtout par leur construction.
D’habitude, je lis Ursula K. Le Guin en anglais. Mais l’occasion était trop bonne, pour ce recueil que je n’avais pas encore, de bénéficier d’une promotion numérique attractive des éditions ActuSF (désolé, elle est terminée au moment où j’écris). C’est donc en français que j’ai parcouru les dix-huit nouvelles qui composent l’ouvrage. Avec une petite impression étrange de ne pas toujours percevoir la fluidité et la clarté de l’autrice dans sa langue d’écriture ; mais je ne saurais dire si cela est dû aux traductions d’Erwan Devos et Hermine Hémon, puisque je n’ai pas consulté la version originale. Il est vrai aussi que les textes de ce recueil sont particulièrement exigeants, par leur style parfois, mais surtout par leur construction.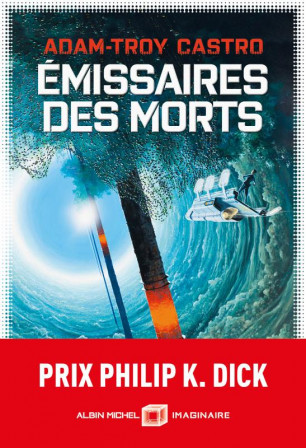 Ce roboratif volume (plus de 700 pages) a été la première incursion en français dans les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à une héroïne particulièrement attachante, Andrea Cort. Composé de quatre longues nouvelles (ou novellas) et du roman éponyme, le projet éditorial permet une entrée fournie dans un monde où les êtres humains, regroupés dans la Confédération homsap, ont essaimé dans l’espace et rencontré d’autres espèces sentientes (dans la mesure où la traduction utilise ce mot, il sera repris ici), établissant au passage des protocoles communs de premier contact et une jurisprudence pointilleuse sur les crimes perpétrés entre espèces. Andrea Cort travaille comme juriste pour le procureur général du Corps diplomatique homsap ; elle a pour mission d’assurer que le traitement des humains liés à des exactions (qu’ils soient victimes ou criminels) sur d’autres mondes est équitable et dans l’intérêt de toutes les parties.
Ce roboratif volume (plus de 700 pages) a été la première incursion en français dans les écrits d’Adam-Troy Castro consacrés à une héroïne particulièrement attachante, Andrea Cort. Composé de quatre longues nouvelles (ou novellas) et du roman éponyme, le projet éditorial permet une entrée fournie dans un monde où les êtres humains, regroupés dans la Confédération homsap, ont essaimé dans l’espace et rencontré d’autres espèces sentientes (dans la mesure où la traduction utilise ce mot, il sera repris ici), établissant au passage des protocoles communs de premier contact et une jurisprudence pointilleuse sur les crimes perpétrés entre espèces. Andrea Cort travaille comme juriste pour le procureur général du Corps diplomatique homsap ; elle a pour mission d’assurer que le traitement des humains liés à des exactions (qu’ils soient victimes ou criminels) sur d’autres mondes est équitable et dans l’intérêt de toutes les parties.

