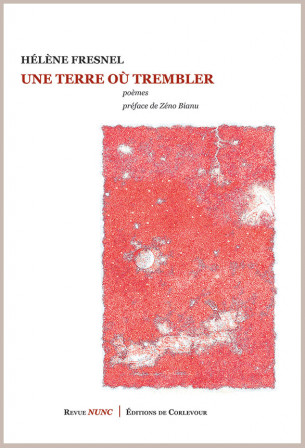« Je ne suis pas une intellectuelle ma voie est celle du cœur ». Avec cette anthologie qui regroupe plusieurs recueils déjà parus et deux inédits, ainsi que divers entretiens à propos de sa pratique poétique (et picturale), Catherine Andrieu confirme en presque trois cents pages la place singulière qu’elle occupe dans le paysage littéraire : celle d’une poétesse à la voix profondément ésotérique, ancrée dans un lyrisme qui convoque transcendance et érotisme, baignée par l’amour et par la mer.
« Je ne suis pas une intellectuelle ma voie est celle du cœur ». Avec cette anthologie qui regroupe plusieurs recueils déjà parus et deux inédits, ainsi que divers entretiens à propos de sa pratique poétique (et picturale), Catherine Andrieu confirme en presque trois cents pages la place singulière qu’elle occupe dans le paysage littéraire : celle d’une poétesse à la voix profondément ésotérique, ancrée dans un lyrisme qui convoque transcendance et érotisme, baignée par l’amour et par la mer.
En « osmose ataraxique », elle convoque ses souvenirs, ses amants, ses amis — parfois disparus dans des circonstances tragiques — pour servir des vers libres biographiques où éclate entre autres sa passion fougueuse pour Paname, son chat disparu : « Tu as le secret de mes nuits étoilées / La rue illuminée le soir, le manège que tu regardes / Couché sur le balcon les bateaux / Je me mets au piano et nous glissons / Sur l’eau. » Le piano est en effet une autre composante des vers de l’écrivaine, qui le pratique inlassablement, au bord de la mer, d’abord la Méditerranée puis l’océan Atlantique (« L’écume des vagues porte les émotions des hommes », nous dit-elle encore). Catherine Andrieu semble, dans un élan inusité de métempsychose, s’incarner dans l’instrument. Celui-ci, aux côtés du chat, préside au déploiement de vers très charnels dans lesquels se dessine une métaphysique assumée : « La nature de ce que nous avons noué dans cette vie / Est de l’ordre du Mystère, amour trans-espèce / Folie, destin et tragédie. »
À cette dernière énumération, on pourrait ajouter obsession : lorsque la violence apparaît, elle est encore et toujours offrande à l’animal fétiche ; il s’agit d’« éclater ta boîte crânienne la cervelle ira au chat ». Ainsi la poétesse trace-t-elle avec ténacité son chemin de page en page, convoquant le souvenir de celles et ceux qui ont compté pour elle, humains ou animaux, s’appliquant à écrire et vivre un programme de jouissance malgré tous les coups portés à l’existence, comme on le lui conseille : « Tu dis écris ou jouis du piano, l’essentiel / Est de jouir. » Le piano encore, obsession mélodique, alter ego qui génère le rythme des poèmes aussi. L’antispécisme qui irrigue ce volume (« Dans une vie antérieure, j’ai été mouette ») constitue un autre leitmotiv offrant au titre sa pertinence : c’est dans le recueil consacré au peintre Anora Borra, autre de ses amis, qu’elle évoque Léda, laquelle « résiste à sa capture sur la toile ». Catherine Andrieu, elle, ne résiste pas à se livrer, nue sous ses vers, dans un élan ou souvent le cosmos est l’horizon du poème. « Je suis une vieille âme livrée au vent de l’Océan. »
Catherine Andrieu, Des nouvelles de Léda ?, Rafael de Surtis, 273 p., 25 €, ISBN 9782846725866
Cette chronique a paru dans le numéro 109 (et dernier) du poézine Traction-brabant, à retrouver ici. Merci à Patrice Maltaverne pour son accueil toutes ces années.
Un extrait :
Dans tes yeux de chat j’ai vu
L’horizon, l’étoile rouge qui brûlera
Encore longtemps après notre amour
J’ai jeté les partitions pour piano
Elles étaient trop gaies
Pour ma mégalo je suis celle qui joue
Du piano sur l’eau je suis virtuose
Si on m’écoute bercer mon petit chat
On m’admire car les réverbères sont des étoiles
Au sol
Reste dans mes bras pour t’endormir
Après la piqûre.
C’était quoi la probabilité de notre rencontre
Ici sur cette Terre d’Océan
Maintenant tout est noyé.

 « Sous les doigts on sent battre le sang » : dans ce recueil se développe une véritable poésie de l’effort, qui scrute de ses vers, strophe après strophe, les membres, les organes, « les peaux les humeurs / les textures nos viandes », tout ce qui compose un être humain en mouvement. Les extrasystoles, ces contractions prématurées du cœur, sont ainsi provoquées par la course à pied, activité propice à l’écoute du corps. Des spasmes se déclenchent, les yeux se plissent parfois. Le vocabulaire anatomique est décliné de page en page, dans une foulée généreuse d’images mais aussi de pensées, souvent liées à la morphologie : « certains mots n’ont pas de voix / les dire – quelle importance / leur silence habite l’espace / crânien / c’est tout ».
« Sous les doigts on sent battre le sang » : dans ce recueil se développe une véritable poésie de l’effort, qui scrute de ses vers, strophe après strophe, les membres, les organes, « les peaux les humeurs / les textures nos viandes », tout ce qui compose un être humain en mouvement. Les extrasystoles, ces contractions prématurées du cœur, sont ainsi provoquées par la course à pied, activité propice à l’écoute du corps. Des spasmes se déclenchent, les yeux se plissent parfois. Le vocabulaire anatomique est décliné de page en page, dans une foulée généreuse d’images mais aussi de pensées, souvent liées à la morphologie : « certains mots n’ont pas de voix / les dire – quelle importance / leur silence habite l’espace / crânien / c’est tout ». « Montre-moi ton passe-partout / et je te dirai quel gauchiasse tu es. » Dès le poème qui ouvre le recueil, ça cogne. Et ça ne s’arrêtera pas : Tomasz Bąk observe, critique, ironise, n’épargne personne, pas plus « les promoteurs des valeurs progressistes » de gauche que « les attachés aux valeurs culturelles » de droite. Oui, ça cogne. « Tape, je te dis. Vise le système et frappe. » Dans ce monde désolant que sa génération a hérité, le jeune poète écrit entre autres sa colère sourde face à une société où « il n’y a pas de conte de fées qu’on ne puisse transformer en porno ». C’est à un flux d’images ininterrompu qu’il nous convie, faisant défiler devant nos yeux les scènes qu’on pourrait voir sur les chaînes d’information continue, les commentant avec un humour sec qui refuse le politiquement correct : « les Jaunes produisent, les Noirs vendent, / les Blancs en tirent profit. Et chacun est satisfait, le monde tourne ainsi. » Comment Tomasz Bąk en est-il arrivé à ce constat ? En partant d’un match de football entre les Pays-Bas et l’Angleterre, puisque sa soif d’interpréter ou de décortiquer la société prend sa source dans le quotidien qu’il scrute, et puis en laissant couler les mots.
« Montre-moi ton passe-partout / et je te dirai quel gauchiasse tu es. » Dès le poème qui ouvre le recueil, ça cogne. Et ça ne s’arrêtera pas : Tomasz Bąk observe, critique, ironise, n’épargne personne, pas plus « les promoteurs des valeurs progressistes » de gauche que « les attachés aux valeurs culturelles » de droite. Oui, ça cogne. « Tape, je te dis. Vise le système et frappe. » Dans ce monde désolant que sa génération a hérité, le jeune poète écrit entre autres sa colère sourde face à une société où « il n’y a pas de conte de fées qu’on ne puisse transformer en porno ». C’est à un flux d’images ininterrompu qu’il nous convie, faisant défiler devant nos yeux les scènes qu’on pourrait voir sur les chaînes d’information continue, les commentant avec un humour sec qui refuse le politiquement correct : « les Jaunes produisent, les Noirs vendent, / les Blancs en tirent profit. Et chacun est satisfait, le monde tourne ainsi. » Comment Tomasz Bąk en est-il arrivé à ce constat ? En partant d’un match de football entre les Pays-Bas et l’Angleterre, puisque sa soif d’interpréter ou de décortiquer la société prend sa source dans le quotidien qu’il scrute, et puis en laissant couler les mots.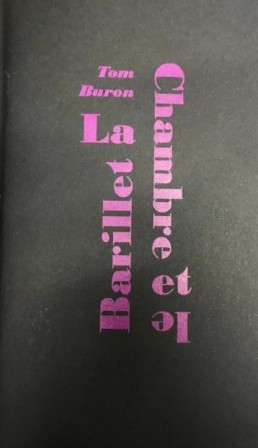 Dès le début, Tom Buron « percute et brésille le verbe ». C’est donc au sein du « territoire de la langue » qu’évolue ce recueil, territoire d’intense intérêt sur lequel le poète entend reprendre le contrôle, car il est devenu champ de bataille : « Une nuit qu’ils remaniaient la langue / en baroqueries industrielles et remplissaient / leurs missions dans les combustibles, / des centurions / prenaient d’assaut la périphérie ». Avec les « dogues du vendredi soir » comme antagonistes, La Chambre et le Barillet tient du récit de bataille épique contre le désenchantement provoqué par la standardisation du discours. La preuve ? Une abondance de mots rares et précieux — paraclet, hérésiarque… tiens, est-ce un hasard si ces vocables relèvent du champ religieux ? — qui font leurs emplettes dans « la grande épicerie / de la langue française ».
Dès le début, Tom Buron « percute et brésille le verbe ». C’est donc au sein du « territoire de la langue » qu’évolue ce recueil, territoire d’intense intérêt sur lequel le poète entend reprendre le contrôle, car il est devenu champ de bataille : « Une nuit qu’ils remaniaient la langue / en baroqueries industrielles et remplissaient / leurs missions dans les combustibles, / des centurions / prenaient d’assaut la périphérie ». Avec les « dogues du vendredi soir » comme antagonistes, La Chambre et le Barillet tient du récit de bataille épique contre le désenchantement provoqué par la standardisation du discours. La preuve ? Une abondance de mots rares et précieux — paraclet, hérésiarque… tiens, est-ce un hasard si ces vocables relèvent du champ religieux ? — qui font leurs emplettes dans « la grande épicerie / de la langue française ».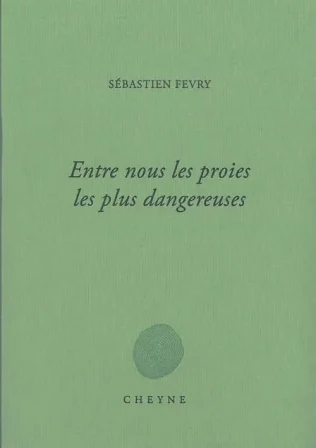 Il y a tant d’allusions à des séries télévisées ou à des films américains dans ce recueil que le poète prévient, dans sa note explicative finale : beaucoup sont « trop fugaces pour être mentionnées ». On ne saurait donc jurer que Desperate Housewives y est évoqué ; Sébastien Fevry nous emmène en tout cas dans un univers poétique où une « allée de garage / [ressemble] à une piste sacrificielle » et où on se demande « qui était la femme derrière les rideaux / et quel homme soupirait à ses pieds, le visage enfoncé / dans la moquette épaisse ». Les poèmes fonctionnent comme autant de saynètes où un secret se révèle, un instant clé se déploie, un paysage se dévoile : « tout se ressemble / dans ce pays qui étale largement sa surface / procédant par étagements successifs / d’étendues d’eau triste ».
Il y a tant d’allusions à des séries télévisées ou à des films américains dans ce recueil que le poète prévient, dans sa note explicative finale : beaucoup sont « trop fugaces pour être mentionnées ». On ne saurait donc jurer que Desperate Housewives y est évoqué ; Sébastien Fevry nous emmène en tout cas dans un univers poétique où une « allée de garage / [ressemble] à une piste sacrificielle » et où on se demande « qui était la femme derrière les rideaux / et quel homme soupirait à ses pieds, le visage enfoncé / dans la moquette épaisse ». Les poèmes fonctionnent comme autant de saynètes où un secret se révèle, un instant clé se déploie, un paysage se dévoile : « tout se ressemble / dans ce pays qui étale largement sa surface / procédant par étagements successifs / d’étendues d’eau triste ». À quoi tient la visibilité d’un recueil de poésie (je n’ose parler de succès pour notre niche littéraire bien-aimée) ? Souvent aux efforts déployés par son auteur ou autrice pour le présenter à son cercle de connaissances, à grands coups de réseaux sociaux. De ce livre qui n’a pas été montré sur ceux-ci, Antoine Gallardo, son éditeur, dit avoir vendu en tout et pour tout… onze exemplaires après sa sortie, en 2021 [erratum pour la version en ligne : il s’agit de onze exemplaires entre début 2022 (et pas la sortie en 2021) et l’annonce des prix CoPo], avant qu’Il saignera des cordes reçoive le prix CoPo et le prix CoPo des lycéens en 2023. Beau doublé. Réparons donc une injustice en lui consacrant cette note dans Traction-brabant, gage s’il en est de notoriété !
À quoi tient la visibilité d’un recueil de poésie (je n’ose parler de succès pour notre niche littéraire bien-aimée) ? Souvent aux efforts déployés par son auteur ou autrice pour le présenter à son cercle de connaissances, à grands coups de réseaux sociaux. De ce livre qui n’a pas été montré sur ceux-ci, Antoine Gallardo, son éditeur, dit avoir vendu en tout et pour tout… onze exemplaires après sa sortie, en 2021 [erratum pour la version en ligne : il s’agit de onze exemplaires entre début 2022 (et pas la sortie en 2021) et l’annonce des prix CoPo], avant qu’Il saignera des cordes reçoive le prix CoPo et le prix CoPo des lycéens en 2023. Beau doublé. Réparons donc une injustice en lui consacrant cette note dans Traction-brabant, gage s’il en est de notoriété !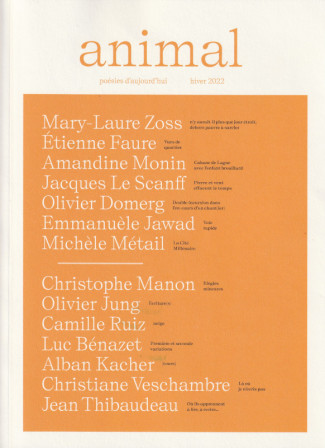 Animal paraît sur papier chaque hiver, avec une première livraison en ligne chaque printemps. On se concentrera ici pour des raisons de longueur sur les textes hivernaux (sachant que des illustrations sont aussi proposées), mais on ne peut qu’encourager lecteurs et lectrices à se rendre sur le site
Animal paraît sur papier chaque hiver, avec une première livraison en ligne chaque printemps. On se concentrera ici pour des raisons de longueur sur les textes hivernaux (sachant que des illustrations sont aussi proposées), mais on ne peut qu’encourager lecteurs et lectrices à se rendre sur le site  Que se cache-t-il derrière ce titre au réjouissant ton professoral et au charme désuet ? Dans le prologue, un « curieux soldat cowboy » se promène à travers champs et repart avec « un tournesol / dans sa main gauche / un estomac / dans sa main droite ». Si Thomas Pourchayre plante ainsi son décor, c’est que son recueil comporte un programme : évoquer ce processus essentiel – et méconnu – qu’est pour nous la digestion, lien fondamental à un environnement naturel dont nous ignorons souvent la fascinante diversité.
Que se cache-t-il derrière ce titre au réjouissant ton professoral et au charme désuet ? Dans le prologue, un « curieux soldat cowboy » se promène à travers champs et repart avec « un tournesol / dans sa main gauche / un estomac / dans sa main droite ». Si Thomas Pourchayre plante ainsi son décor, c’est que son recueil comporte un programme : évoquer ce processus essentiel – et méconnu – qu’est pour nous la digestion, lien fondamental à un environnement naturel dont nous ignorons souvent la fascinante diversité. Si Christine de Pizan (vers 1365 - vers 1430) a souvent figuré dans des anthologies, combien d’enthousiastes de la poésie peuvent se targuer d’avoir lu un de ses ouvrages en entier ? En voici venu le temps, en tout cas : de cette féministe avant le mot vient de reparaître deux fois ce chef-d’œuvre, d’abord en 2019 aux éditions Gallimard dans une traduction de Jacqueline Cerquiglini-Toulet, puis cette année — c’est à cette version que nous nous intéressons — aux éditions Lurlure dans une traduction de Bertrand Rouziès-Léonardi, lequel avait officié pour le truculent Trubert chez le même éditeur.
Si Christine de Pizan (vers 1365 - vers 1430) a souvent figuré dans des anthologies, combien d’enthousiastes de la poésie peuvent se targuer d’avoir lu un de ses ouvrages en entier ? En voici venu le temps, en tout cas : de cette féministe avant le mot vient de reparaître deux fois ce chef-d’œuvre, d’abord en 2019 aux éditions Gallimard dans une traduction de Jacqueline Cerquiglini-Toulet, puis cette année — c’est à cette version que nous nous intéressons — aux éditions Lurlure dans une traduction de Bertrand Rouziès-Léonardi, lequel avait officié pour le truculent Trubert chez le même éditeur. « Poète obscur » — à en croire sa bio un rien provocatrice —, Heptanes Fraxion traîne ses guêtres de trublion des mots dans les petites maisons d’édition depuis quelques années, après un passage remarqué par la publication de textes sur les réseaux sociaux, qu’il pratique d’ailleurs toujours. Son style ? Un mélange détonant des registres de langage, qui peuvent aller du vulgaire au précieux, au service de vers où perce une passion dévorante pour le vécu des autres, des sans-grade, des personnes qui ne sont pas chantées par les discours officiels et les manuels d’histoire rédigés par les vainqueurs. Et puis une fascination pour les freaks, aussi. Dans Ni chagrin d’amour ni combat de reptiles, n’écrit-il pas « quand je me laisse aller à la gentillesse des gens bien / jamais je n’oublie la franchise des monstres » ?
« Poète obscur » — à en croire sa bio un rien provocatrice —, Heptanes Fraxion traîne ses guêtres de trublion des mots dans les petites maisons d’édition depuis quelques années, après un passage remarqué par la publication de textes sur les réseaux sociaux, qu’il pratique d’ailleurs toujours. Son style ? Un mélange détonant des registres de langage, qui peuvent aller du vulgaire au précieux, au service de vers où perce une passion dévorante pour le vécu des autres, des sans-grade, des personnes qui ne sont pas chantées par les discours officiels et les manuels d’histoire rédigés par les vainqueurs. Et puis une fascination pour les freaks, aussi. Dans Ni chagrin d’amour ni combat de reptiles, n’écrit-il pas « quand je me laisse aller à la gentillesse des gens bien / jamais je n’oublie la franchise des monstres » ?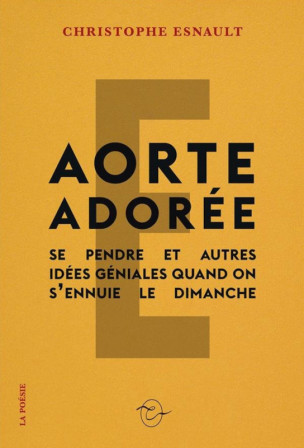 Ce qu’il y a de bien chez Christophe Esnault, c’est qu’il ne ressert pas la même poésie dans tous ses livres, nombreux maintenant. Jugez-en plutôt à ses deux dernières publications : il a conté son enfance de pêcheur dans le nostalgique recueil L’Enfant poisson-chat chez publie.net, puis son expérience de la dysphorie dans la vindicative et logorrhéique
Ce qu’il y a de bien chez Christophe Esnault, c’est qu’il ne ressert pas la même poésie dans tous ses livres, nombreux maintenant. Jugez-en plutôt à ses deux dernières publications : il a conté son enfance de pêcheur dans le nostalgique recueil L’Enfant poisson-chat chez publie.net, puis son expérience de la dysphorie dans la vindicative et logorrhéique  Sur la couverture, des oiseaux survolent un paysage qui à première vue semble fait de collines, de vagues peut-être, dans les traits desquelles on devine pourtant des jambes ou des bras stylisés, étirés. Les très belles illustrations de SIXN pour le livre de Gorguine Valougeorgis sont à l’image des mots du poète : à une portion concrète et narrative, elles offrent un contrepoint onirique qui permet de dépasser l’anecdote. Et si bien entendu c’est de texte que je souhaite d’abord parler dans ces chroniques, il importe ici de mentionner la qualité des encres qui accompagnent celui-ci, car elles frappent d’emblée par leur adéquation.
Sur la couverture, des oiseaux survolent un paysage qui à première vue semble fait de collines, de vagues peut-être, dans les traits desquelles on devine pourtant des jambes ou des bras stylisés, étirés. Les très belles illustrations de SIXN pour le livre de Gorguine Valougeorgis sont à l’image des mots du poète : à une portion concrète et narrative, elles offrent un contrepoint onirique qui permet de dépasser l’anecdote. Et si bien entendu c’est de texte que je souhaite d’abord parler dans ces chroniques, il importe ici de mentionner la qualité des encres qui accompagnent celui-ci, car elles frappent d’emblée par leur adéquation. C’est par l’oralité que j’ai rencontré Aldo Qureshi : il recevait en octobre dernier, au Marché de la poésie, le prix CoPo des lycéens pour La Nuit de la graisse, premier épisode d’une série qui continue avec le récent Roi de la sueur. Par cœur, avec une intonation pince-sans-rire qui déclenchait les fous rires dans l’assistance. Je suis allé sur-le-champ me procurer ses ouvrages. Si vous en avez l’occasion, ne vous contentez pas de lire Aldo, savourez aussi ses performances. Mais revenons à nos glandes sudoripares.
C’est par l’oralité que j’ai rencontré Aldo Qureshi : il recevait en octobre dernier, au Marché de la poésie, le prix CoPo des lycéens pour La Nuit de la graisse, premier épisode d’une série qui continue avec le récent Roi de la sueur. Par cœur, avec une intonation pince-sans-rire qui déclenchait les fous rires dans l’assistance. Je suis allé sur-le-champ me procurer ses ouvrages. Si vous en avez l’occasion, ne vous contentez pas de lire Aldo, savourez aussi ses performances. Mais revenons à nos glandes sudoripares.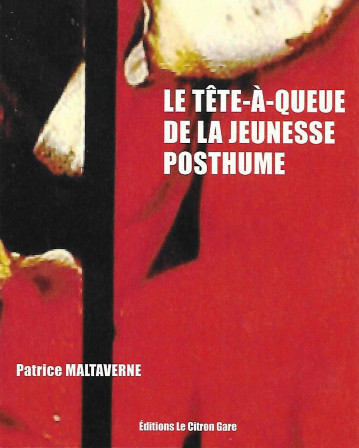 À l’occasion de ses cinquante ans, Patrice Maltaverne – oui, l’animateur de ce poézine ! – a rassemblé cinquante de ses textes écrits entre 1989 et 2020, soit inédits, soit déjà parus en revues (auxquelles un bel hommage est rendu) ou en anthologies. Manière de poser cet autoportrait « sans reniement d’aucune sorte », ainsi qu’il le mentionne dans son introduction, il le publie au Citron Gare, la maison d’édition qu’il dirige et qui fêtera bientôt ses dix ans. Il faut interpréter ce choix comme le reflet d’une indépendance viscérale, d’une envie de se présenter tel qu’il est, en poète de qualité que le Maltaverne revuiste et chroniqueur, infatigable arpenteur de la poésie française, éclipse parfois dans l’esprit de certaines ou certains.
À l’occasion de ses cinquante ans, Patrice Maltaverne – oui, l’animateur de ce poézine ! – a rassemblé cinquante de ses textes écrits entre 1989 et 2020, soit inédits, soit déjà parus en revues (auxquelles un bel hommage est rendu) ou en anthologies. Manière de poser cet autoportrait « sans reniement d’aucune sorte », ainsi qu’il le mentionne dans son introduction, il le publie au Citron Gare, la maison d’édition qu’il dirige et qui fêtera bientôt ses dix ans. Il faut interpréter ce choix comme le reflet d’une indépendance viscérale, d’une envie de se présenter tel qu’il est, en poète de qualité que le Maltaverne revuiste et chroniqueur, infatigable arpenteur de la poésie française, éclipse parfois dans l’esprit de certaines ou certains.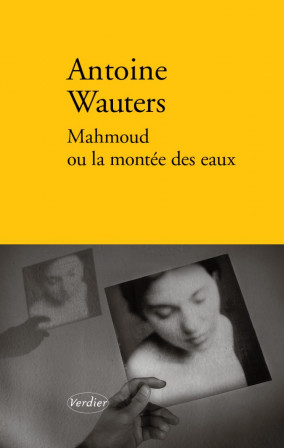 Il a déjà été question dans cette chronique d’un autre roman en vers (
Il a déjà été question dans cette chronique d’un autre roman en vers (
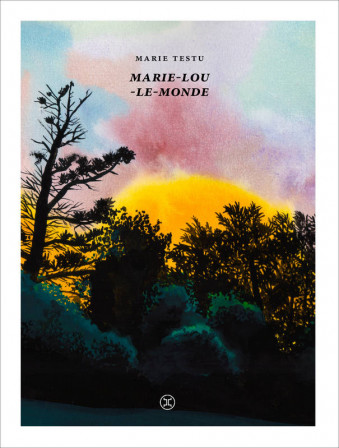

 Quarante-huit pages, plutôt aérées : Matin sur le soleil, de Silvia Majerska, paru au Cadran ligné, n’est pas un recueil fleuve. Il fait partie de ces livres où la concentration des sentiments, le décantage progressif et, on l’imagine, le rabotage savant des mots prennent le pas sur la volubilité. Parfaits exemples de cette volonté de concision, les titres se réduisent à un substantif (quelques très rares adjectifs s’immiscent), comme des totems qui se dressent pour commémorer l’essence des poèmes. La première partie, « Cube de Pandore », s’attache à porter un regard de biais sur des objets ou actes du quotidien, dont les instantanés génèrent une réflexion par ricochet, un brin philosophique mais aussi dotée d’une pointe d’humour. Ainsi cet « Arc-en-ciel » : « Tu ne peux voir rien qui dépasserait / les limites d’un arc-en-ciel // Et tu me regardes pourtant / toujours de travers ». Loin des jolis poèmes où nature et sentiments se rejoignent dans un style fleuri et immédiat, les textes de Silvia Majerska dégagent un parfum de finitions méticuleuses. Combien de poèmes a-t-elle écartés avant de composer cet ensemble, combien de mots se sont vu passer à la révision intégrale ? En tout cas, la profondeur est ici inversement proportionnelle à l’épaisseur du livre.
Quarante-huit pages, plutôt aérées : Matin sur le soleil, de Silvia Majerska, paru au Cadran ligné, n’est pas un recueil fleuve. Il fait partie de ces livres où la concentration des sentiments, le décantage progressif et, on l’imagine, le rabotage savant des mots prennent le pas sur la volubilité. Parfaits exemples de cette volonté de concision, les titres se réduisent à un substantif (quelques très rares adjectifs s’immiscent), comme des totems qui se dressent pour commémorer l’essence des poèmes. La première partie, « Cube de Pandore », s’attache à porter un regard de biais sur des objets ou actes du quotidien, dont les instantanés génèrent une réflexion par ricochet, un brin philosophique mais aussi dotée d’une pointe d’humour. Ainsi cet « Arc-en-ciel » : « Tu ne peux voir rien qui dépasserait / les limites d’un arc-en-ciel // Et tu me regardes pourtant / toujours de travers ». Loin des jolis poèmes où nature et sentiments se rejoignent dans un style fleuri et immédiat, les textes de Silvia Majerska dégagent un parfum de finitions méticuleuses. Combien de poèmes a-t-elle écartés avant de composer cet ensemble, combien de mots se sont vu passer à la révision intégrale ? En tout cas, la profondeur est ici inversement proportionnelle à l’épaisseur du livre.