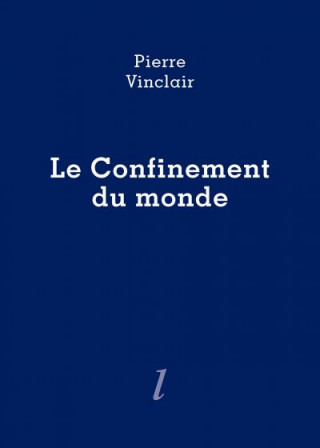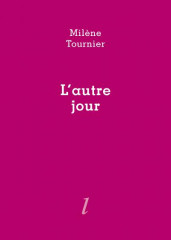Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes.
Titre énigmatique que celui de ce recueil, tout juste éclairé par la quatrième de couverture, où on lit que l’endroit aigu « s’anime dans certains moments inconfortables. C’est le lieu d’irritation au creux du ventre où s’agitent la peur de la mort et les terreurs nocturnes ». Pourtant, point d’horreur ou de malaise dans les premières pages. Au contraire, « J’avais cœur frais et / sans atours », confie Pauline de Vergnette sur un rythme allant. Les déterminants qui sautent fleurent bon le trobar, d’autant que des rimes se glissent par endroits, juste ce qu’il faut pour que la sonorité happe l’attention. Très vite, cependant, « ça ferraille / dans la gorge lancer de pierres / de carnavals et de vipères ». Invention langagière sous la plume (« j’ai doudouché mes creux perdus », « je dermatille tant et si bien / qu’au bout du compte ma peau fait / des vaguelettes »), la trobairitz en puissance (« la rose la primevère / vont chanter une chanson ») fait osciller ses vers entre gorge nouée et joie enfantine. Comme si la poésie était un remède à l’inexorable avancée en âge, avec ce que cela comporte de désillusions : « j’ai plus envie de parler avec humains faire les choses / les adultes il faut faire il y a des responsabilités ». Parfois, les rimes deviennent omniprésentes, le rythme se fait comptine : « je préfère mon chat aux humains / mon chat je peux le prendre / dans le creux de ma main / il est vraiment gentil et doux / c’est un tout mignon petit bout ». Décidément, la poétesse n’a pas l’intention de grandir, se berce elle-même de ses strophes… puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-on lui donner tort ? Avec l’énergie de « la chamade en tous états », elle affirme vouloir « rouler mulholland drive / ma vie ma vie je n’ai plus d’arme / sonne moi moi sonne sonne ma larme », et on embarque avec elle vers le pays magique d’une enfance qui se prolonge, par le truchement des mots qui se transforment en notes de musique ou images de film. Vers la fin du livre, revoilà l’endroit aigu. Pour le contrôler, nous dit la poétesse, elle « glisse un peu et tire plus bas et tente / (sans succès) / de [s]’efflorer à l’arme blanche », elle « force l’ouverture dans [son] ventre / et fourrage sans pitié ». Drôle de grand écart entre la douceur des comptines et l’angoisse qui vrille des clous qu’il faut s’arracher du corps. C’est ce qui rend ces quelque soixante pages palpitantes.
Pauline de Vergnette, L’Endroit aigu, éditions Lurlure, ISBN 979-10-95997-61-0
Extrait audio :


 Constante, quasi lancinante, l’adresse à « madame » qui emplit chaque page du recueil pose la question de savoir quelle destinataire se cache derrière cette politesse scandée. « le monde est laid, madame, mais nous écrivons des lettres à des êtres symboliques » : il serait peut-être trop simple de n’y voir qu’un symbole, cependant. Nathanaëlle Quoirez ne manque pas, dans son alternance de lettres en prose poétique et de poèmes en vers libres centrés, de glisser des indices ; mais ne sont-ils pas contradictoires ? Puisque la « pupille bain de mutisme [de madame] / donne à ma plaie son engelure », on pourrait opter pour un amour vache. Mais dans ce « réel magique, pendant intime ensorcelé », avec un « poids de bure à porter », les références à Dieu sont tellement présentes qu’on verrait bien madame en madone. « votre effigie, madame, je tremble / tranchée dans l’hystérie » : l’effigie est-elle ainsi la clé ? D’autant que nombre de phrases évoquent l’accouchement, l’enfantement, que nombre de scènes se passent en milieu hospitalier — souffrance de soi, des autres, du corps qui se traduit en paroles écorchées sur la page. Et que les références à l’écriture sont aussi légion : « vous savez, madame, ma typographie ligature quand la corde manuscrite esclave, moi je désire comme l’autre jour ma soif, brusque fond d’où me brasser. » Mais foin des tentatives d’interprétation (et il y en aurait tant d’autres que celles exprimées avant), puisque la poésie consignée dans un livre appartient au fond à celui ou celle qui la lit, pas au chroniqueur, fût-il enthousiaste. En vérité, ce serait se priver du plaisir de la langue de la poétesse que de se laisser accaparer tout le long de l’ouvrage par la question de l’identité de « madame ». On se délectera plutôt des bouleversements verbaux, des télescopages de substantifs, de la modestie lyrique qui fait de l’autrice une « mouche piquée d’ego avec pour proie sa propre merde ». Car Lettres à Madame tourne parfois à la prière, mais la déférence aveugle n’y est pas de mise : « que mon dieu est petite / sangsue à la poitrine / un clou de braise le matin vermillon ». C’est avec pugnacité devant l’adversité (et là, on est face à une réalité qui ne souffre pas d’interprétation) que Nathanaëlle Quoirez apostrophe madame, la tance, la flatte, la caresse de vers et de phrases où l’on sent sous la plume « la dent cariée du verbe ». Pour, à travers elle, atteindre une délivrance — qu’elle soit guérison, amour partagé, accouchement, point final d’un recueil… — en forme de pari sur ce qui viendra : « l’avenir recuit son utopie invertébrée. »
Constante, quasi lancinante, l’adresse à « madame » qui emplit chaque page du recueil pose la question de savoir quelle destinataire se cache derrière cette politesse scandée. « le monde est laid, madame, mais nous écrivons des lettres à des êtres symboliques » : il serait peut-être trop simple de n’y voir qu’un symbole, cependant. Nathanaëlle Quoirez ne manque pas, dans son alternance de lettres en prose poétique et de poèmes en vers libres centrés, de glisser des indices ; mais ne sont-ils pas contradictoires ? Puisque la « pupille bain de mutisme [de madame] / donne à ma plaie son engelure », on pourrait opter pour un amour vache. Mais dans ce « réel magique, pendant intime ensorcelé », avec un « poids de bure à porter », les références à Dieu sont tellement présentes qu’on verrait bien madame en madone. « votre effigie, madame, je tremble / tranchée dans l’hystérie » : l’effigie est-elle ainsi la clé ? D’autant que nombre de phrases évoquent l’accouchement, l’enfantement, que nombre de scènes se passent en milieu hospitalier — souffrance de soi, des autres, du corps qui se traduit en paroles écorchées sur la page. Et que les références à l’écriture sont aussi légion : « vous savez, madame, ma typographie ligature quand la corde manuscrite esclave, moi je désire comme l’autre jour ma soif, brusque fond d’où me brasser. » Mais foin des tentatives d’interprétation (et il y en aurait tant d’autres que celles exprimées avant), puisque la poésie consignée dans un livre appartient au fond à celui ou celle qui la lit, pas au chroniqueur, fût-il enthousiaste. En vérité, ce serait se priver du plaisir de la langue de la poétesse que de se laisser accaparer tout le long de l’ouvrage par la question de l’identité de « madame ». On se délectera plutôt des bouleversements verbaux, des télescopages de substantifs, de la modestie lyrique qui fait de l’autrice une « mouche piquée d’ego avec pour proie sa propre merde ». Car Lettres à Madame tourne parfois à la prière, mais la déférence aveugle n’y est pas de mise : « que mon dieu est petite / sangsue à la poitrine / un clou de braise le matin vermillon ». C’est avec pugnacité devant l’adversité (et là, on est face à une réalité qui ne souffre pas d’interprétation) que Nathanaëlle Quoirez apostrophe madame, la tance, la flatte, la caresse de vers et de phrases où l’on sent sous la plume « la dent cariée du verbe ». Pour, à travers elle, atteindre une délivrance — qu’elle soit guérison, amour partagé, accouchement, point final d’un recueil… — en forme de pari sur ce qui viendra : « l’avenir recuit son utopie invertébrée. » Voilà un petit livre réjouissant, qui brille de concision et de malice. Sur le modèle des Histoires naturelles de Jules Renard (si vous ne les connaissez pas, un tour sur le site
Voilà un petit livre réjouissant, qui brille de concision et de malice. Sur le modèle des Histoires naturelles de Jules Renard (si vous ne les connaissez pas, un tour sur le site  « Un journal devrait être secret. / Pour ressembler à la vie. / Notre vie est secrète. / Le reste, c’est du jour. » Peut-être même
« Un journal devrait être secret. / Pour ressembler à la vie. / Notre vie est secrète. / Le reste, c’est du jour. » Peut-être même  Les éditions Lurlure, avec la publication de ce poème « héroï-comique », ont décidément de la suite dans les idées. En effet, à leur catalogue figurent tant de la poésie épique – on pense au délicieux Trubert – que des livres qui font la part belle à l’alexandrin – en particulier plusieurs de Pierre Vinclair. Et ça tombe bien, puisque Laurent Albarracin propose ici une épopée en vers de douze pieds par un groupe de Pieds nickelés de la poésie. « C’était un château assez vieux et merveilleux. / Tout un tas de trucs croissaient, et pas que du lierre » : et voilà nos héros, parmi lesquels nombre de usual suspects notamment des éditions Lurlure, de la revue en ligne Catastrophes (où le livre a été publié en feuilleton) ou de la maison d’édition d’Albarracin lui-même – Le Cadran ligné –, partant à l’assaut de l’édifice. La quête emprunte au style médiéval pour mieux y faire grincer des mots et expressions modernes, dans des alexandrins qui claquent et des situations improbables : « — Mais comment peut-on voguer sur la mer antique / Et dans un couloir ? demanda Charles-Mézence. / — Tu nous fais chier avec tes questions de logique / Lui fut-il rétorqué sur un ton peu amène. » Au cours de cette geste de 1 400 vers, les paladins, les paladines et l’auteur s’emploient, se taquinent, s’essaient à des considérations philosophiques détournées ou à des comparaisons farcesques : « L’espace résistait comme du Nutella / Quand tu le sors du frigo (mais qui l’a mis là ?). » D’ailleurs, prévient Albarracin, « Le beau n’est pas l’intrigue et sa véracité / Mais ce qui est imprévu que la rime amène », et l’on se régale de l’invention qu’on devine tirée du fil de sa plume. Les Blemmyes, « curieux êtres acéphales », attaquent le petit groupe d’assaillants alors que celui-ci est parvenu dans la tour de garde. Mais la créature la plus terrible est évidemment le dragon… pardon, le « leucocrotte », qu’il leur faudra combattre avec toute la force de leur intelligence collective. Quoi d’autre, du reste, pour des poètes qui n’ont pas brillé avant par leur adaptation à l’armement médiéval ? Fidèle aux épopées chevaleresques mais aussi ancré dans la modernité par son vocabulaire et son intertextualité (point besoin cependant de connaître les œuvres des protagonistes pour l’apprécier), Le Château qui flottait est un texte réjouissant et inventif de poésie narrative et ironique, toujours « Avecque l’énergie d’un bel alexandrin ».
Les éditions Lurlure, avec la publication de ce poème « héroï-comique », ont décidément de la suite dans les idées. En effet, à leur catalogue figurent tant de la poésie épique – on pense au délicieux Trubert – que des livres qui font la part belle à l’alexandrin – en particulier plusieurs de Pierre Vinclair. Et ça tombe bien, puisque Laurent Albarracin propose ici une épopée en vers de douze pieds par un groupe de Pieds nickelés de la poésie. « C’était un château assez vieux et merveilleux. / Tout un tas de trucs croissaient, et pas que du lierre » : et voilà nos héros, parmi lesquels nombre de usual suspects notamment des éditions Lurlure, de la revue en ligne Catastrophes (où le livre a été publié en feuilleton) ou de la maison d’édition d’Albarracin lui-même – Le Cadran ligné –, partant à l’assaut de l’édifice. La quête emprunte au style médiéval pour mieux y faire grincer des mots et expressions modernes, dans des alexandrins qui claquent et des situations improbables : « — Mais comment peut-on voguer sur la mer antique / Et dans un couloir ? demanda Charles-Mézence. / — Tu nous fais chier avec tes questions de logique / Lui fut-il rétorqué sur un ton peu amène. » Au cours de cette geste de 1 400 vers, les paladins, les paladines et l’auteur s’emploient, se taquinent, s’essaient à des considérations philosophiques détournées ou à des comparaisons farcesques : « L’espace résistait comme du Nutella / Quand tu le sors du frigo (mais qui l’a mis là ?). » D’ailleurs, prévient Albarracin, « Le beau n’est pas l’intrigue et sa véracité / Mais ce qui est imprévu que la rime amène », et l’on se régale de l’invention qu’on devine tirée du fil de sa plume. Les Blemmyes, « curieux êtres acéphales », attaquent le petit groupe d’assaillants alors que celui-ci est parvenu dans la tour de garde. Mais la créature la plus terrible est évidemment le dragon… pardon, le « leucocrotte », qu’il leur faudra combattre avec toute la force de leur intelligence collective. Quoi d’autre, du reste, pour des poètes qui n’ont pas brillé avant par leur adaptation à l’armement médiéval ? Fidèle aux épopées chevaleresques mais aussi ancré dans la modernité par son vocabulaire et son intertextualité (point besoin cependant de connaître les œuvres des protagonistes pour l’apprécier), Le Château qui flottait est un texte réjouissant et inventif de poésie narrative et ironique, toujours « Avecque l’énergie d’un bel alexandrin ».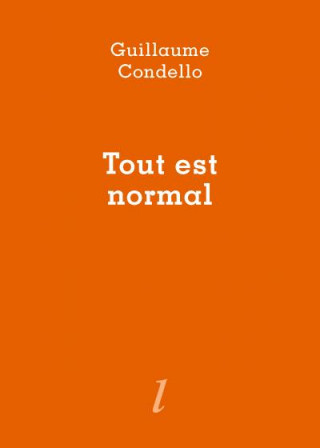 « Une chronique fragmentée du quotidien » : c’est ainsi qu’est présenté le livre sur le site de son éditeur. Bien entendu, c’est rigoureusement exact, en dix chants et quatre interludes. Ce que je retiens cependant, c’est l’adjectif « fragmentée », qui me semble le fil conducteur du recueil. C’est que la fragmentation des vers, des phrases, des paragraphes, des strophes est omniprésente, avec ses réminiscences de collages aussi, installant un rythme qui paraît celui de la respiration de son auteur. Souvent, les tabulations avant ou au sein des vers ont, au mieux, dans une certaine poésie, juste une signification graphique, d’aération. Dans Tout est normal, cette aération sert le texte, devient expiration… puis inspiration, bonne nouvelle pour un poète ! La forme est parfaitement travaillée par Guillaume Condello, qui propose des tranches de vie composées comme autant de regards furtifs matérialisés par ses vers fuyants, à trous, parsemés d’italique, de citations. Preuve s’il en est de l’attention portée à la forme, encore : la non-utilisation du point (à de rares exceptions bien précises), sauf pour montrer la prononciation des mots, en l’espèce la diérèse (« une déclarati.on solennelle », « il aurait fallu fi.èrement lui jeter / comme des fleurs »). Et puis à un interlude en haïkus succède ce chant où l’on peut lire le japonisant : « lui aussi sans pourquoi le cerisier fleurit / encore blanc pourquoi / (ce n’est pas / un sakura) ». Décidément, le poète a de la suite dans les idées. Mais on n’aime pas un recueil pour sa seule maîtrise formelle, bien entendu. Du côté du fond, pour en revenir à la fragmentation, lecteurs et lectrices se voient proposer un regard observateur sur l’époque à travers des épisodes, des chants divers et variés, tel le premier intitulé « De l’autre côté de l’écran » : « au-dehors / au téléphone / en fleurs jeunes / garçons et filles riant / museaux de lapinous oreilles de kitty / leurs images inversées dans / l’écran liquide où former / des cristaux de vie ». Nirvana y rencontre Téléchat, les élections présidentielles depuis 1981 sont présentées par leurs animations graphiques qui révèlent le visage de l’heureux élu à 20 heures, l’amour est autant le souvenir de tentatives d’écriture de poèmes que la lecture d’un numéro d’Union récupéré lors d’un intérim comme éboueur. Allez, soyons franc : si ces poèmes nous touchent, c’est qu’ils savent faire vibrer en nous des expériences passées, présentes, voire à venir. Oui, l’auteur de ce billet a aussi été éboueur (mais n’a jamais lu Union) pour gagner un peu d’argent en été. Tout comme il a été démarché par des témoins de Jéhovah qui sonnaient chez toutes les personnes avec un nom à consonance italienne ; dans « Apocalypse à peu près », « Signore Condello » signe peut-être son chant le plus émouvant, où la visite des « représentants en commerce des âmes » italophones provoque une vague de souvenirs de mots calabrais, puis verse dans l’horreur : « la Bête est déjà là elle hante l’Europe en haillons le chiffre sur son front ». Mais d’apocalypse point, finalement. Juste « un frisson / de vent » qui passe dans le dos du poète, après avoir congédié les fâcheux. Et, à nouveau, après la fragmentation du réel poétique, tout est normal.
« Une chronique fragmentée du quotidien » : c’est ainsi qu’est présenté le livre sur le site de son éditeur. Bien entendu, c’est rigoureusement exact, en dix chants et quatre interludes. Ce que je retiens cependant, c’est l’adjectif « fragmentée », qui me semble le fil conducteur du recueil. C’est que la fragmentation des vers, des phrases, des paragraphes, des strophes est omniprésente, avec ses réminiscences de collages aussi, installant un rythme qui paraît celui de la respiration de son auteur. Souvent, les tabulations avant ou au sein des vers ont, au mieux, dans une certaine poésie, juste une signification graphique, d’aération. Dans Tout est normal, cette aération sert le texte, devient expiration… puis inspiration, bonne nouvelle pour un poète ! La forme est parfaitement travaillée par Guillaume Condello, qui propose des tranches de vie composées comme autant de regards furtifs matérialisés par ses vers fuyants, à trous, parsemés d’italique, de citations. Preuve s’il en est de l’attention portée à la forme, encore : la non-utilisation du point (à de rares exceptions bien précises), sauf pour montrer la prononciation des mots, en l’espèce la diérèse (« une déclarati.on solennelle », « il aurait fallu fi.èrement lui jeter / comme des fleurs »). Et puis à un interlude en haïkus succède ce chant où l’on peut lire le japonisant : « lui aussi sans pourquoi le cerisier fleurit / encore blanc pourquoi / (ce n’est pas / un sakura) ». Décidément, le poète a de la suite dans les idées. Mais on n’aime pas un recueil pour sa seule maîtrise formelle, bien entendu. Du côté du fond, pour en revenir à la fragmentation, lecteurs et lectrices se voient proposer un regard observateur sur l’époque à travers des épisodes, des chants divers et variés, tel le premier intitulé « De l’autre côté de l’écran » : « au-dehors / au téléphone / en fleurs jeunes / garçons et filles riant / museaux de lapinous oreilles de kitty / leurs images inversées dans / l’écran liquide où former / des cristaux de vie ». Nirvana y rencontre Téléchat, les élections présidentielles depuis 1981 sont présentées par leurs animations graphiques qui révèlent le visage de l’heureux élu à 20 heures, l’amour est autant le souvenir de tentatives d’écriture de poèmes que la lecture d’un numéro d’Union récupéré lors d’un intérim comme éboueur. Allez, soyons franc : si ces poèmes nous touchent, c’est qu’ils savent faire vibrer en nous des expériences passées, présentes, voire à venir. Oui, l’auteur de ce billet a aussi été éboueur (mais n’a jamais lu Union) pour gagner un peu d’argent en été. Tout comme il a été démarché par des témoins de Jéhovah qui sonnaient chez toutes les personnes avec un nom à consonance italienne ; dans « Apocalypse à peu près », « Signore Condello » signe peut-être son chant le plus émouvant, où la visite des « représentants en commerce des âmes » italophones provoque une vague de souvenirs de mots calabrais, puis verse dans l’horreur : « la Bête est déjà là elle hante l’Europe en haillons le chiffre sur son front ». Mais d’apocalypse point, finalement. Juste « un frisson / de vent » qui passe dans le dos du poète, après avoir congédié les fâcheux. Et, à nouveau, après la fragmentation du réel poétique, tout est normal.