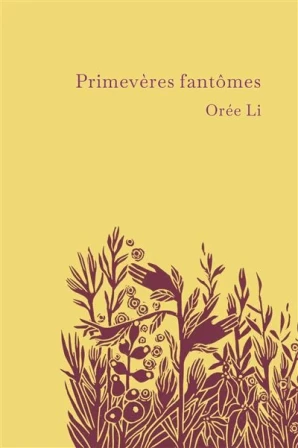 « Je prends la suite des poètes qui écrivirent le flottement des cheveux des saules dans la douceur du matin. » Sommes-nous dans la seule et simple contemplation de la nature ? Pas du tout, bien sûr, et Orée Li, qui a « appris par cœur la douleur des fleurs », le révèle dès la partie introductive, où « le corps s’immobilise / et le regard s’ouvre / plus loin que prévu ». Plus loin, c’est, on l’apprendra, viser « la symbiose inespérée », l’harmonie totale avec un vivant autre, en l’occurrence celui des végétaux : « J’arrose mon système / nerveux de lavande », grand huit des espèces, « cavalcade dans le tunnel sans parois ». La musique des mots (« un piano de microbiotes s’en vient ») est un prélude au mélange des formes vivantes, végétaux d’abord certes, mais les animaux ne sont pas en reste (« kératine à éclore / en germination dinosaures »). Au fil du livre, malgré le « mugissement de l’écocide » — ce n’est pas un hasard si l’une des parties convoque Rachel Carson en exergue —, contre celui-ci même, puisque la poésie est également combat, Orée Li se fond dans les plantes, « dans l’oraison des fleurs » ; son corps ne fait plus qu’un avec Brassica nigra (la moutarde noire), expérimente « en silence ce que nous pourrions appeler la conscience fluide ». Pour ce faire, le recueil mélange prose poétique, vers libres classiques ou mots savamment disposés sur la page, pour une respiration au rythme de la chlorophylle. Hors d’un corps humain aussi, la poésie est traversée par le désir, tant la fascination des multiples accouplements entre fleurs et abeilles se fait prégnante, « une ruche sauvage / au point G ». Et l’on pense aux écrits de la philosophe des sciences Vinciane Despret, même si cette dernière concentre ses recherches sur nos rapports avec les animaux plutôt que sur notre relation aux végétaux. En tout cas, Orée Li plante un recueil absorbant, où l’amour finit d’ailleurs par triompher, cyprine et sève mêlées, après une montée en tension haletante. Gage de fluidité, des glyphes non binaires à l’élégance chatoyante viennent ponctuer ses vers ; une page du livre est reproduite ci-dessous pour en donner une idée. « La poésie, c’est fait pour faire des arcs-en-ciel avec les armatures de la mort. Des arcs-en-ciel de terre » : avec Orée Li et ce superbe premier livre publié, on retourne à la terre pour entrer en symbiose avec les plantes, pour explorer la conscience de l’altérité. Oui, nous sommes aussi des fleurs.
« Je prends la suite des poètes qui écrivirent le flottement des cheveux des saules dans la douceur du matin. » Sommes-nous dans la seule et simple contemplation de la nature ? Pas du tout, bien sûr, et Orée Li, qui a « appris par cœur la douleur des fleurs », le révèle dès la partie introductive, où « le corps s’immobilise / et le regard s’ouvre / plus loin que prévu ». Plus loin, c’est, on l’apprendra, viser « la symbiose inespérée », l’harmonie totale avec un vivant autre, en l’occurrence celui des végétaux : « J’arrose mon système / nerveux de lavande », grand huit des espèces, « cavalcade dans le tunnel sans parois ». La musique des mots (« un piano de microbiotes s’en vient ») est un prélude au mélange des formes vivantes, végétaux d’abord certes, mais les animaux ne sont pas en reste (« kératine à éclore / en germination dinosaures »). Au fil du livre, malgré le « mugissement de l’écocide » — ce n’est pas un hasard si l’une des parties convoque Rachel Carson en exergue —, contre celui-ci même, puisque la poésie est également combat, Orée Li se fond dans les plantes, « dans l’oraison des fleurs » ; son corps ne fait plus qu’un avec Brassica nigra (la moutarde noire), expérimente « en silence ce que nous pourrions appeler la conscience fluide ». Pour ce faire, le recueil mélange prose poétique, vers libres classiques ou mots savamment disposés sur la page, pour une respiration au rythme de la chlorophylle. Hors d’un corps humain aussi, la poésie est traversée par le désir, tant la fascination des multiples accouplements entre fleurs et abeilles se fait prégnante, « une ruche sauvage / au point G ». Et l’on pense aux écrits de la philosophe des sciences Vinciane Despret, même si cette dernière concentre ses recherches sur nos rapports avec les animaux plutôt que sur notre relation aux végétaux. En tout cas, Orée Li plante un recueil absorbant, où l’amour finit d’ailleurs par triompher, cyprine et sève mêlées, après une montée en tension haletante. Gage de fluidité, des glyphes non binaires à l’élégance chatoyante viennent ponctuer ses vers ; une page du livre est reproduite ci-dessous pour en donner une idée. « La poésie, c’est fait pour faire des arcs-en-ciel avec les armatures de la mort. Des arcs-en-ciel de terre » : avec Orée Li et ce superbe premier livre publié, on retourne à la terre pour entrer en symbiose avec les plantes, pour explorer la conscience de l’altérité. Oui, nous sommes aussi des fleurs.
Orée Li, Primevères fantômes, éditions des Lisières, ISBN 979-10-96274-43-7


 L’écriture de Marina Skalova, ici, se fait cri. Cri de protestation, de rage, de fureur devant la violence structurelle envers les femmes dans une société faite en majorité par et pour les hommes. Quel angle nouveau apporte la poétesse sur un thème qui, désormais et tant mieux, fait beaucoup littérature ? La poésie, justement. Une poésie narrative que nourrit son rythme : les vers sont autant de phrases scandées qui piquent, brûlent, blessent autant que peuvent blesser les hommes par manque de considération, ignorance, mais aussi par désir d’assurer leur domination. Une poésie de l’arroseur arrosé, donc, dans un océan où peu remettent en cause une société patriarcale toute-puissante. Poésie du souvenir aussi, avec l’amour d’enfance « souvent délicat et ridicule / il avait lieu sous des herbes hautes, l’été / dans la campagne autour des datchas ». C’est que l’autrice veut aussi mettre au jour, pour partir d’un cas concret et atteindre l’universel, la violence larvée qui surgit de la langue russe, dès le plus jeune âge ; elle cite par conséquent des phrases issues de ce que l’on pourrait nommer ironiquement la sagesse populaire et va même jusqu’à fournir, dans une mise en pages très réussie qui en entoure sa poésie, des extraits d’un manuel russe des années 1920 consacré à la vie sexuelle et conjugale. « Les hommes inspiraient la crainte / surtout ne pas les froisser / ne pas les offenser » : puis on remonte le fil du temps de l’enfance pour une première violence sexuelle dans un train : « Il a la main sur ta cuisse / il caresse son jean / au-dessous de sa braguette / il tient quelque chose / il fait des mouvements / au bord de sa cuisse ». Il y en aura d’autres… Viennent ensuite les consultations gynécologiques : « Les hommes envoient des sondes / dans le ventre des femmes / et dans l’espace. » L’accouchement, ses suites, l’indifférence complice du personnel, l’arrachement à la mère de l’enfant pour des vérifications médicales standardisées sans empathie, tout est crûment décrit, balancé sur la page sans ménagement. Et vous, « si on vous coupait un bout de bite, / vous seriez d’accord pour avoir des enfants » ? Intiment, dans le titre, c’est bien le verbe intimer conjugué à la troisième personne du pluriel, on l’apprend dès la première page. Le double sens qui convoque l’intimité est patent, et l’ardeur de cette écriture a pour elle sa concision et sa sidérante vitalité. Entre l’abattement et la colère, la poétesse choisit le cri.
L’écriture de Marina Skalova, ici, se fait cri. Cri de protestation, de rage, de fureur devant la violence structurelle envers les femmes dans une société faite en majorité par et pour les hommes. Quel angle nouveau apporte la poétesse sur un thème qui, désormais et tant mieux, fait beaucoup littérature ? La poésie, justement. Une poésie narrative que nourrit son rythme : les vers sont autant de phrases scandées qui piquent, brûlent, blessent autant que peuvent blesser les hommes par manque de considération, ignorance, mais aussi par désir d’assurer leur domination. Une poésie de l’arroseur arrosé, donc, dans un océan où peu remettent en cause une société patriarcale toute-puissante. Poésie du souvenir aussi, avec l’amour d’enfance « souvent délicat et ridicule / il avait lieu sous des herbes hautes, l’été / dans la campagne autour des datchas ». C’est que l’autrice veut aussi mettre au jour, pour partir d’un cas concret et atteindre l’universel, la violence larvée qui surgit de la langue russe, dès le plus jeune âge ; elle cite par conséquent des phrases issues de ce que l’on pourrait nommer ironiquement la sagesse populaire et va même jusqu’à fournir, dans une mise en pages très réussie qui en entoure sa poésie, des extraits d’un manuel russe des années 1920 consacré à la vie sexuelle et conjugale. « Les hommes inspiraient la crainte / surtout ne pas les froisser / ne pas les offenser » : puis on remonte le fil du temps de l’enfance pour une première violence sexuelle dans un train : « Il a la main sur ta cuisse / il caresse son jean / au-dessous de sa braguette / il tient quelque chose / il fait des mouvements / au bord de sa cuisse ». Il y en aura d’autres… Viennent ensuite les consultations gynécologiques : « Les hommes envoient des sondes / dans le ventre des femmes / et dans l’espace. » L’accouchement, ses suites, l’indifférence complice du personnel, l’arrachement à la mère de l’enfant pour des vérifications médicales standardisées sans empathie, tout est crûment décrit, balancé sur la page sans ménagement. Et vous, « si on vous coupait un bout de bite, / vous seriez d’accord pour avoir des enfants » ? Intiment, dans le titre, c’est bien le verbe intimer conjugué à la troisième personne du pluriel, on l’apprend dès la première page. Le double sens qui convoque l’intimité est patent, et l’ardeur de cette écriture a pour elle sa concision et sa sidérante vitalité. Entre l’abattement et la colère, la poétesse choisit le cri. Dans la présentation de l’auteur en fin de livre, on apprend qu’« il aime ce qui est hybride ». Bien souvent, la délicate tâche de se présenter incombe à l’écrivain, lequel doit ainsi se soumettre à la convention de parler de lui-même à la troisième personne. L’exercice ajoute par conséquent ladite troisième personne à l’hybridation que chérit Felip Costaglioli : dans le corps du texte, le « je » poétique aura en effet déjà alterné le masculin et le féminin, se donnant « nu / sur un sofa » puis « liée et / nue » comme un « fou ruban ». La cohérence des images, le rythme qui parcourt tous les poèmes — avec des vers courts, espacés, néanmoins piqués de quelques strophes aux lignes plus longues et quasi en prose —, tout indique que nous sommes là devant un ensemble qui brosse le portrait hybride, donc, d’un narrateur ou d’une narratrice prêtant à voir sa bizarrerie ou sa singularité. L’un des titres, « Mes curiosités », le laisse d’ailleurs entendre. Grâce au poète, la réalité se fait magique : « un pèlerin intérieur / exige // que tout me taille », tandis qu’un « cabri // vient / en moi // lécher // la plus belle / de mes plaies ». « Comme nous », les vers « frémissent », dans des assemblages brefs de mots saillants. « À la fois // couronne / et grenouille », Felip et ses avatars explorent l’étrangeté des contes tout autant que « ces temps / improbables // où tout / évince ». Le pas de côté devient la règle, le décalage, une poétique qui sert la fluidité. Fluidité des vocables certes, mais aussi cette fluidité du genre dont on parle beaucoup en ce moment et qui, ici, sait elle-même parler, ce qui n’est pas rien. Il fallait bien la poésie pour ça. N’oublions pas non plus les clins d’œil (volontaires ?) : alors qu’on peut lire sur une page « Ça coud / dans les // lisières » (le recueil paraît aux éditions des Lisières), la page suivante affirme qu’« Il y a longtemps que / je ne tranche plus ». L’auteur a été, rappelons-le, publié également à La Boucherie littéraire… et quelque chose me dit que ces vers ne sont donc pas anodins. En tout cas, c’est à une hybridation subtile et joyeuse que le poète nous convie dans ce tout petit livre, qui est aussi un bien bel objet.
Dans la présentation de l’auteur en fin de livre, on apprend qu’« il aime ce qui est hybride ». Bien souvent, la délicate tâche de se présenter incombe à l’écrivain, lequel doit ainsi se soumettre à la convention de parler de lui-même à la troisième personne. L’exercice ajoute par conséquent ladite troisième personne à l’hybridation que chérit Felip Costaglioli : dans le corps du texte, le « je » poétique aura en effet déjà alterné le masculin et le féminin, se donnant « nu / sur un sofa » puis « liée et / nue » comme un « fou ruban ». La cohérence des images, le rythme qui parcourt tous les poèmes — avec des vers courts, espacés, néanmoins piqués de quelques strophes aux lignes plus longues et quasi en prose —, tout indique que nous sommes là devant un ensemble qui brosse le portrait hybride, donc, d’un narrateur ou d’une narratrice prêtant à voir sa bizarrerie ou sa singularité. L’un des titres, « Mes curiosités », le laisse d’ailleurs entendre. Grâce au poète, la réalité se fait magique : « un pèlerin intérieur / exige // que tout me taille », tandis qu’un « cabri // vient / en moi // lécher // la plus belle / de mes plaies ». « Comme nous », les vers « frémissent », dans des assemblages brefs de mots saillants. « À la fois // couronne / et grenouille », Felip et ses avatars explorent l’étrangeté des contes tout autant que « ces temps / improbables // où tout / évince ». Le pas de côté devient la règle, le décalage, une poétique qui sert la fluidité. Fluidité des vocables certes, mais aussi cette fluidité du genre dont on parle beaucoup en ce moment et qui, ici, sait elle-même parler, ce qui n’est pas rien. Il fallait bien la poésie pour ça. N’oublions pas non plus les clins d’œil (volontaires ?) : alors qu’on peut lire sur une page « Ça coud / dans les // lisières » (le recueil paraît aux éditions des Lisières), la page suivante affirme qu’« Il y a longtemps que / je ne tranche plus ». L’auteur a été, rappelons-le, publié également à La Boucherie littéraire… et quelque chose me dit que ces vers ne sont donc pas anodins. En tout cas, c’est à une hybridation subtile et joyeuse que le poète nous convie dans ce tout petit livre, qui est aussi un bien bel objet.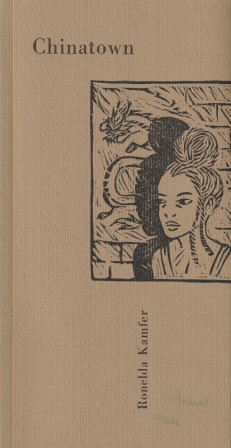 À la lecture de Chinatown, on se trouve rapidement partagé entre l’envie de voir l’autrice, dont on sent, on sait que les vers sont autobiographiques, échapper à ce carcan sud-africain de violence et de racisme larvé qu’elle capture dans ses poèmes et la fascination pour ce qu’elle dévoile d’une société qui, en miroir, nous fait soupirer de soulagement que la nôtre n’en soit pas (encore ?) rendue là. Car rarement vie rangée et bien réglée aura forgé le déchaînement poétique, et si Ronelda Kamfer peut tancer les « bourges du ghetto », c’est qu’elle se sent un peu comme telle, même si elle tape fort sur ceux-ci. « mes poèmes ne sont pas des confessions », titre-t-elle cependant ; « mes poèmes ne sont pas pour les féministes / mes poèmes sont pour les femmes à la cuisine / mes poèmes sont pour les gosses métis et noirs / dans une classe d’enfants blancs ». L’Afrique du Sud comme nation arc-en-ciel y prend de sacrés coups : « souviens-toi qu’une femme blanche est un homme blanc », prévient la poétesse, refusant toute sororité mièvre. Comment en effet se solidariser avec « une femme blanche dans une plantation / qui crève de jalousie quand son mari / viole l’esclave » ? Les vers de Ronelda Kamfer ne sont pourtant pas uniquement rancuniers, revendicatifs, voire violents, dans leurs diatribes. Leur ton manie l’ironie avec beaucoup de panache, et la société marchande est tout autant mise en accusation que le racisme ordinaire, avec ce centre commercial qui donne son titre au livre, à la « richesse de pacotille dans / cette merde clinquante qui brûle les yeux / et cette odeur d’inutilité ». La famille y est aussi très présente, et notamment le père. Pas en bien. Pas non plus tout à fait en mal, comme si l’autrice voulait aussi faire peser le déterminisme social dans la balance au moment de composer ses vers. Et puis, au-delà des thèmes brûlants qu’aborde le recueil, il y a la langue. Excellente idée de proposer ce livre en version bilingue, qui permet de goûter le mélange si sonore et rythmé du kaaps, qui vient de l’afrikaans (langue de la colonisation), parlé au Cap et qui intègre des expressions anglaises à ce dérivé du néerlandais. Cela donne une furieuse envie de l’entendre, et la magie de l’internet le permet :
À la lecture de Chinatown, on se trouve rapidement partagé entre l’envie de voir l’autrice, dont on sent, on sait que les vers sont autobiographiques, échapper à ce carcan sud-africain de violence et de racisme larvé qu’elle capture dans ses poèmes et la fascination pour ce qu’elle dévoile d’une société qui, en miroir, nous fait soupirer de soulagement que la nôtre n’en soit pas (encore ?) rendue là. Car rarement vie rangée et bien réglée aura forgé le déchaînement poétique, et si Ronelda Kamfer peut tancer les « bourges du ghetto », c’est qu’elle se sent un peu comme telle, même si elle tape fort sur ceux-ci. « mes poèmes ne sont pas des confessions », titre-t-elle cependant ; « mes poèmes ne sont pas pour les féministes / mes poèmes sont pour les femmes à la cuisine / mes poèmes sont pour les gosses métis et noirs / dans une classe d’enfants blancs ». L’Afrique du Sud comme nation arc-en-ciel y prend de sacrés coups : « souviens-toi qu’une femme blanche est un homme blanc », prévient la poétesse, refusant toute sororité mièvre. Comment en effet se solidariser avec « une femme blanche dans une plantation / qui crève de jalousie quand son mari / viole l’esclave » ? Les vers de Ronelda Kamfer ne sont pourtant pas uniquement rancuniers, revendicatifs, voire violents, dans leurs diatribes. Leur ton manie l’ironie avec beaucoup de panache, et la société marchande est tout autant mise en accusation que le racisme ordinaire, avec ce centre commercial qui donne son titre au livre, à la « richesse de pacotille dans / cette merde clinquante qui brûle les yeux / et cette odeur d’inutilité ». La famille y est aussi très présente, et notamment le père. Pas en bien. Pas non plus tout à fait en mal, comme si l’autrice voulait aussi faire peser le déterminisme social dans la balance au moment de composer ses vers. Et puis, au-delà des thèmes brûlants qu’aborde le recueil, il y a la langue. Excellente idée de proposer ce livre en version bilingue, qui permet de goûter le mélange si sonore et rythmé du kaaps, qui vient de l’afrikaans (langue de la colonisation), parlé au Cap et qui intègre des expressions anglaises à ce dérivé du néerlandais. Cela donne une furieuse envie de l’entendre, et la magie de l’internet le permet : « qui modèle qui ? » Voilà bien la question centrale de ce recueil, tant il semble entériner la fusion entre un chien et sa maîtresse, qui n’est certainement autre que l’autrice : dès le départ et un aparté sur le terme « poétesse », on perçoit en effet le vécu dans ces vers qui respirent l’alliance interespèces. Si modelage il y a, il est d’abord mutuel et respectueux. Comme le chien ne peut écrire de livre, Perrine Le Querrec cherche à « trouver l’écriture canine / donner sa langue au chien ». Le titre montre bien le programme, dans la tradition de The Horse and His Boy de C. S. Lewis par exemple. En promenade ou à la maison, « la pensée c’est le chien / le poumon qui se gonfle / l’aorte qui bat ». L’acuité du regard ou du flair canins se glissent dans les vers pour atteindre une sensorialité mixte : qui, de la maîtresse (« elle dresse les oreilles ») ou de l’animal (« le chien saisit / au vol les mots »), décrit ces saynètes introspectives où tous deux semblent seuls dans un monde que peuple surtout la nature ? Le parangon peut-être, avec ce s là où on attendrait « ensemble », qui laisse planer un doute quant à la réelle fusion : « seuls et ensembles / la fille et le chien étendus / sous les palmes monumentales / de la fougère ». Et puis chaque poème long est suivi d’un résumé en italique, chaque vers étant composé en général d’un unique mot. De cette manière est exprimée l’essence du texte qui précède, mais on peut également imaginer ce procédé comme une traduction en langage chien de l’essentiel. Nous voilà dans un recueil de poésie bilingue et affectueux : « os / caresses / mouillée / lumière / dit-elle / oiseau ». On voyage ainsi dans la tête de deux êtres unis par-delà la barrière des espèces, et même si « tout ici / est extrait de la caverne / de l’imagination », on s’ouvre à l’altérité canine par le biais magique de la poésie.
« qui modèle qui ? » Voilà bien la question centrale de ce recueil, tant il semble entériner la fusion entre un chien et sa maîtresse, qui n’est certainement autre que l’autrice : dès le départ et un aparté sur le terme « poétesse », on perçoit en effet le vécu dans ces vers qui respirent l’alliance interespèces. Si modelage il y a, il est d’abord mutuel et respectueux. Comme le chien ne peut écrire de livre, Perrine Le Querrec cherche à « trouver l’écriture canine / donner sa langue au chien ». Le titre montre bien le programme, dans la tradition de The Horse and His Boy de C. S. Lewis par exemple. En promenade ou à la maison, « la pensée c’est le chien / le poumon qui se gonfle / l’aorte qui bat ». L’acuité du regard ou du flair canins se glissent dans les vers pour atteindre une sensorialité mixte : qui, de la maîtresse (« elle dresse les oreilles ») ou de l’animal (« le chien saisit / au vol les mots »), décrit ces saynètes introspectives où tous deux semblent seuls dans un monde que peuple surtout la nature ? Le parangon peut-être, avec ce s là où on attendrait « ensemble », qui laisse planer un doute quant à la réelle fusion : « seuls et ensembles / la fille et le chien étendus / sous les palmes monumentales / de la fougère ». Et puis chaque poème long est suivi d’un résumé en italique, chaque vers étant composé en général d’un unique mot. De cette manière est exprimée l’essence du texte qui précède, mais on peut également imaginer ce procédé comme une traduction en langage chien de l’essentiel. Nous voilà dans un recueil de poésie bilingue et affectueux : « os / caresses / mouillée / lumière / dit-elle / oiseau ». On voyage ainsi dans la tête de deux êtres unis par-delà la barrière des espèces, et même si « tout ici / est extrait de la caverne / de l’imagination », on s’ouvre à l’altérité canine par le biais magique de la poésie. Rendez-vous compte : il n’y avait pas encore eu de traduction en français d’un poète aïnou ! Et pourtant, on sait que la poésie est souvent acte de résistance par excellence — les Aïnous, peuple autochtone du Nord de l’actuel Japon, jadis aussi implantés dans la Russie proche et à l’embouchure du fleuve Amour, assimilés depuis des siècles par les puissants voisins japonais, ont donc évidemment fait acte de résistance à l’expansion nipponne au moyen de poésie. Mais leur langue, isolée dans la région, est maintenant en voie d’extinction. C’est d’ailleurs en japonais — certes mêlé de vocables aïnous — qu’Iboshi Hokuto (1901-1929) a composé son Carnet, qui constitue la base de cette traduction bienvenue.
Rendez-vous compte : il n’y avait pas encore eu de traduction en français d’un poète aïnou ! Et pourtant, on sait que la poésie est souvent acte de résistance par excellence — les Aïnous, peuple autochtone du Nord de l’actuel Japon, jadis aussi implantés dans la Russie proche et à l’embouchure du fleuve Amour, assimilés depuis des siècles par les puissants voisins japonais, ont donc évidemment fait acte de résistance à l’expansion nipponne au moyen de poésie. Mais leur langue, isolée dans la région, est maintenant en voie d’extinction. C’est d’ailleurs en japonais — certes mêlé de vocables aïnous — qu’Iboshi Hokuto (1901-1929) a composé son Carnet, qui constitue la base de cette traduction bienvenue.

