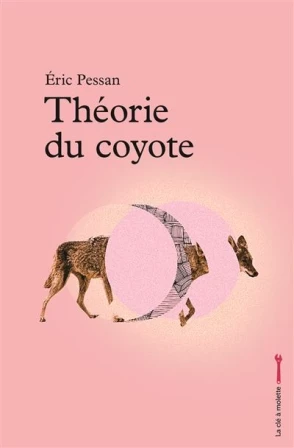 « Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une performance de Joseph Beuys), mais sait aussi que tout le monde ne l’avait pas pendant la soirée. Il en va ainsi d’une certaine culture : avouer son ignorance ne se fait pas. Page après page, Pessan plaide, convoquant moult exemples d’ateliers d’écriture qu’il a animés ou de rencontres faites lors d’une résidence dans la région de Montbéliard, pour une culture inclusive et diverse. Celle-ci comprendrait aussi bien les pulps de science-fiction que Madame de La Fayette, Bach que Céline Dion, les films grand public que les productions pointues… sans pourtant que ce soit une sinécure : « On ne devrait jamais dire que lire ou aller au musée ou écouter une symphonie est facile. C’est un grand mensonge. La culture demande des efforts. Le problème n’est pas là. Le problème est : pourquoi valorise-t-on l’effort sportif et non l’effort culturel ? » (On pourrait remarquer que l’effort fourni pour écouter une chanson de Taylor Swift ne peut se comparer en intensité à celui nécessaire à comprendre et à apprécier une fugue de Bach, mais là n’est justement pas le propos.) La clé, répète-t-il, est l’éducation. Prenant son exemple personnel, il montre que quelqu’un qui n’était pas destiné par son milieu familial à être écrivain à plein temps a pu le devenir grâce au soutien de profs ou de personnes de bon conseil, dans l’ouverture et la tolérance. Même s’il est difficile de vivre du métier d’écrivain, il ne le cache pas, pointant les inégalités flagrantes dans toute la chaîne du livre. En ces temps incertains, de repli souvent, de mépris parfois, il fait cependant montre de solidarité, d’optimisme, d’allant. Quiconque participe de près ou de loin à la création de culture devrait lire ce petit livre plein de sagesse, parfois d’amertume, mais rarement de pessimisme quand on a choisi l’action. « Tout comme il est de plus en plus admis que la diminution de la biodiversité est une catastrophe, j’aimerais une défense massive de la culturodiversité. Il n’y aura jamais trop de livres, de spectacles, d’artistes ou de concerts, puisque la réduction s’opère toujours dans les marges ; elle élimine les plus faibles, les formes de création minoritaires, les expérimentations, les recherches les plus aventureuses. Une coupe ici, une entaille là et peu à peu seuls les plus forts survivront, ceux qui s’adressent au plus grand nombre, ceux qui font les meilleures ventes, les plus grandes recettes, les billetteries les plus rentables. Et ceux-là ne sont pas ceux qui innovent, inventent, font des pas de côté. » Il faut continuer à écrire et lire des livres, de tous genres, des pièces, toutes les pièces, écrire et voir des films, tous les films, concevoir et voir des expositions, de toutes les époques, et surtout refuser les coupes budgétaires qui nivellent par le bas.
« Je suis écrivain, donc, mes outils ont servi à comptabiliser les esclaves, à soumettre les populations, à confisquer les communs au profit d’un petit groupe de nantis qui avaient pour eux la maîtrise de l’écriture et l’usage des forces de police. » Loin d’une idéalisation béate, Éric Pessan cherche ici, dans un style qui s’apparente souvent à la réflexion à haute voix, à comprendre ce qu’est la culture et pourquoi elle est si importante — tout le monde s’accorde à le dire, mais les bonnes intentions sont-elles toujours suivies d’effets concrets ? —, sans pour autant gommer les aspects polémiques. Le titre, d’ailleurs, fait référence à une phrase (« Le texte est le coyote ») lâchée par une personne que l’on pourrait qualifier d’initiée, sans contexte, sans explication, lors d’une soirée en librairie. L’écrivain avait la référence (il s’agit d’une performance de Joseph Beuys), mais sait aussi que tout le monde ne l’avait pas pendant la soirée. Il en va ainsi d’une certaine culture : avouer son ignorance ne se fait pas. Page après page, Pessan plaide, convoquant moult exemples d’ateliers d’écriture qu’il a animés ou de rencontres faites lors d’une résidence dans la région de Montbéliard, pour une culture inclusive et diverse. Celle-ci comprendrait aussi bien les pulps de science-fiction que Madame de La Fayette, Bach que Céline Dion, les films grand public que les productions pointues… sans pourtant que ce soit une sinécure : « On ne devrait jamais dire que lire ou aller au musée ou écouter une symphonie est facile. C’est un grand mensonge. La culture demande des efforts. Le problème n’est pas là. Le problème est : pourquoi valorise-t-on l’effort sportif et non l’effort culturel ? » (On pourrait remarquer que l’effort fourni pour écouter une chanson de Taylor Swift ne peut se comparer en intensité à celui nécessaire à comprendre et à apprécier une fugue de Bach, mais là n’est justement pas le propos.) La clé, répète-t-il, est l’éducation. Prenant son exemple personnel, il montre que quelqu’un qui n’était pas destiné par son milieu familial à être écrivain à plein temps a pu le devenir grâce au soutien de profs ou de personnes de bon conseil, dans l’ouverture et la tolérance. Même s’il est difficile de vivre du métier d’écrivain, il ne le cache pas, pointant les inégalités flagrantes dans toute la chaîne du livre. En ces temps incertains, de repli souvent, de mépris parfois, il fait cependant montre de solidarité, d’optimisme, d’allant. Quiconque participe de près ou de loin à la création de culture devrait lire ce petit livre plein de sagesse, parfois d’amertume, mais rarement de pessimisme quand on a choisi l’action. « Tout comme il est de plus en plus admis que la diminution de la biodiversité est une catastrophe, j’aimerais une défense massive de la culturodiversité. Il n’y aura jamais trop de livres, de spectacles, d’artistes ou de concerts, puisque la réduction s’opère toujours dans les marges ; elle élimine les plus faibles, les formes de création minoritaires, les expérimentations, les recherches les plus aventureuses. Une coupe ici, une entaille là et peu à peu seuls les plus forts survivront, ceux qui s’adressent au plus grand nombre, ceux qui font les meilleures ventes, les plus grandes recettes, les billetteries les plus rentables. Et ceux-là ne sont pas ceux qui innovent, inventent, font des pas de côté. » Il faut continuer à écrire et lire des livres, de tous genres, des pièces, toutes les pièces, écrire et voir des films, tous les films, concevoir et voir des expositions, de toutes les époques, et surtout refuser les coupes budgétaires qui nivellent par le bas.
Éric Pessan, Théorie du coyote, éditions La clé à molette, ISBN 979-10-91189-35-4
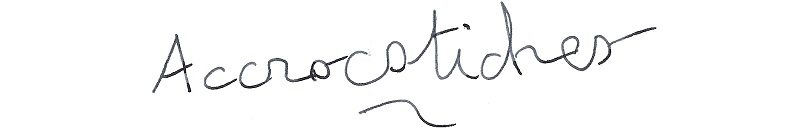
 « Marcher pour écrire, c’est avant tout marcher. L’écriture viendra peut-être plus tard. Le premier effet de la marche, c’est le vide : la disponibilité aux chemins et la mise à distance des pensées trop présentes. » Pendant une résidence à Marseille, Patricia Cartereau et Éric Pessan décident d’explorer le sentier de grande randonnée 2013, par la chaleur caniculaire de l’été 2018, pour ensuite fixer leurs expériences croisées de peinture, dessin et écriture. L’un des intérêts de ce livre est que ce n’est pas celui d’un écrivain et d’une plasticienne dans des rôles définis et séparés ; dans les textes, il faut guetter les accords féminins pour savoir quand la narratrice s’exprime, même si au fil des pages on apprend à distinguer les styles… qui pourtant se fondent l’un dans l’autre comme seuls peuvent le faire ceux d’un couple depuis quasi trente ans à la ville. Si les écrivains marcheurs sont convoqués, si les souvenirs d’enfance ou d’adolescence reviennent à la faveur des déambulations, il n’en reste pas moins que « l’époque est à la méfiance ». On croise des hommes en armes, des clochards pas toujours célestes, des malotrus, des détritus et des crottes de chien disposées pour piéger les randonneurs. Mais le couple sait qu’« il y a de la joie à simplement sentir ses muscles lourds, à ne pas avoir passé la journée devant un écran, à s’être égoïstement coupé des soubresauts du monde ». Quand on met un pied devant l’autre, on gamberge quand même un peu, et l’on sent poindre à la lecture une écoanxiété liée à l’« ère du libéralocène », tandis que Cartereau et Pessan mesurent le privilège qui leur est accordé : « Plus je marche, plus je sais ma chance de marcher pour travailler ma langue. Ce luxe. » Loin de la glorification bobo et ampoulée d’une marche comme retour à la nature, érigée en artifice d’un développement personnel réservé aux plus riches, le couple marche « parce qu’il est inutile de le faire ». Pas pour tout le monde, et nombre de réflexions du livre traduisent en images des différences sociales – des fissures – difficilement justifiables, dans une ville, Marseille, qui les étale en plein soleil d’été. Le statut d’artiste n’est pas une sinécure non plus, mais au moins leurs vies sont-elles « bricolées de joie et de nécessité ». Et puis « la vie est migrante » et le volume gorgé d’empathie. Les mots et les images se répondent, soudain surgissent des séries de doubles pages colorées qui montrent des cailloux fascinants par la variété de leurs surfaces. Il y a à la fois du banal et de la grâce, du café du commerce et de la littérature dans cette prose et ces illustrations qui ont la sagesse de ne pas se laisser aller à l’emphase. Elles croquent un quotidien mis à distance par quelques enjambées, le temps d’une saison que le réchauffement climatique attise. « Peut-être que la littérature a aussi été inventée pour garder mémoire de ce qui n’a pas vraiment d’importance. Sans cela, qui pourrait se souvenir ? » : on se promène avec ce livre sur les ailes du papillon de l’effet du même nom.
« Marcher pour écrire, c’est avant tout marcher. L’écriture viendra peut-être plus tard. Le premier effet de la marche, c’est le vide : la disponibilité aux chemins et la mise à distance des pensées trop présentes. » Pendant une résidence à Marseille, Patricia Cartereau et Éric Pessan décident d’explorer le sentier de grande randonnée 2013, par la chaleur caniculaire de l’été 2018, pour ensuite fixer leurs expériences croisées de peinture, dessin et écriture. L’un des intérêts de ce livre est que ce n’est pas celui d’un écrivain et d’une plasticienne dans des rôles définis et séparés ; dans les textes, il faut guetter les accords féminins pour savoir quand la narratrice s’exprime, même si au fil des pages on apprend à distinguer les styles… qui pourtant se fondent l’un dans l’autre comme seuls peuvent le faire ceux d’un couple depuis quasi trente ans à la ville. Si les écrivains marcheurs sont convoqués, si les souvenirs d’enfance ou d’adolescence reviennent à la faveur des déambulations, il n’en reste pas moins que « l’époque est à la méfiance ». On croise des hommes en armes, des clochards pas toujours célestes, des malotrus, des détritus et des crottes de chien disposées pour piéger les randonneurs. Mais le couple sait qu’« il y a de la joie à simplement sentir ses muscles lourds, à ne pas avoir passé la journée devant un écran, à s’être égoïstement coupé des soubresauts du monde ». Quand on met un pied devant l’autre, on gamberge quand même un peu, et l’on sent poindre à la lecture une écoanxiété liée à l’« ère du libéralocène », tandis que Cartereau et Pessan mesurent le privilège qui leur est accordé : « Plus je marche, plus je sais ma chance de marcher pour travailler ma langue. Ce luxe. » Loin de la glorification bobo et ampoulée d’une marche comme retour à la nature, érigée en artifice d’un développement personnel réservé aux plus riches, le couple marche « parce qu’il est inutile de le faire ». Pas pour tout le monde, et nombre de réflexions du livre traduisent en images des différences sociales – des fissures – difficilement justifiables, dans une ville, Marseille, qui les étale en plein soleil d’été. Le statut d’artiste n’est pas une sinécure non plus, mais au moins leurs vies sont-elles « bricolées de joie et de nécessité ». Et puis « la vie est migrante » et le volume gorgé d’empathie. Les mots et les images se répondent, soudain surgissent des séries de doubles pages colorées qui montrent des cailloux fascinants par la variété de leurs surfaces. Il y a à la fois du banal et de la grâce, du café du commerce et de la littérature dans cette prose et ces illustrations qui ont la sagesse de ne pas se laisser aller à l’emphase. Elles croquent un quotidien mis à distance par quelques enjambées, le temps d’une saison que le réchauffement climatique attise. « Peut-être que la littérature a aussi été inventée pour garder mémoire de ce qui n’a pas vraiment d’importance. Sans cela, qui pourrait se souvenir ? » : on se promène avec ce livre sur les ailes du papillon de l’effet du même nom.

