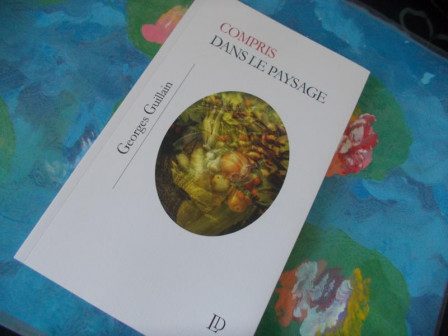Stimulant petit recueil que celui de Michel Talon. On sait que Patrice Maltaverne, le taulier des éditions Le Citron Gare, va chercher dans son poézine Traction-brabant les poètes qu’il souhaite publier — tout en effectuant un véritable travail éditorial collaboratif. Pas étonnant donc que Talon, un pilier dudit poézine, se voie proposer aujourd’hui un recueil. Et c’est une excellente occasion de lire sa poésie du quotidien au phrasé rythmé, souple et polymorphe dans un ensemble de textes cohérent et sur la durée. Car la frustration que génère une revue, fût-elle aussi éclectique et bien pensée dans son inorganisation ostentatoire que Traction-brabant, c’est évidemment de découvrir une écriture sans pouvoir s’y plonger pendant longtemps. Ici, on accompagne l’auteur dans ses pérégrinations poétiques : « J’écoute s’époumoner les tilleuls. / Un orgue nu dévale ma pensée. Irrésistible. » Ce sont des fragments de vie, d’impressions, courtes phrases parfois sans verbe mais à la narration évidente. Les choses s’y personnifient, les êtres se fondent dans le mélange des scènes : « Relais H. Dans les gobelets, le café tape le journal, / l’ouvre en grand. Les titres ronflent ou gazouillent. » Le talent de Michel Talon est de ne pas forcer les images, sans pour autant se laisser aller à une langue facile ou trop simplement naturelle. Il y a du travail dans ces poèmes, un travail de collage des mots, des êtres et des choses où « Les Cubaines sur leur 31 accompagnent / un poème de Lorca » et où « Le givre a chaussé ses petites bottines vernies, sans voix ». Le patchwork guide l’émotion, l’assemblage est celui des meilleurs crus ; les couches successives se déposent jusqu’à ce que l’agate prenne forme, et on contemple le travail des millénaires en de simples poèmes brefs.
Michel Talon, Dans les agates, éditions Le Citron Gare, ISBN 978-2-9561971-4-0

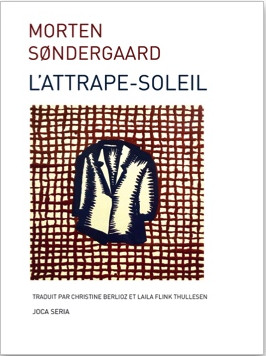





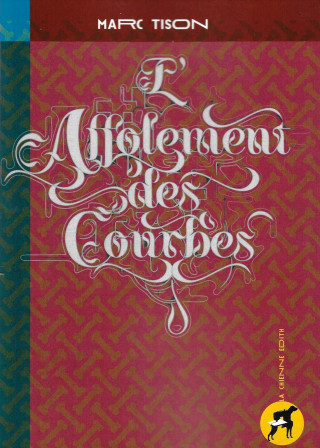 Sauvage, la poésie de Marc Tison l’est certainement. Je ne dirais pas à l’opposé de l’homme lui-même, car il est tout de même rock’n’roll, Marc, mais enfin il a aussi ce charme posé de celui qui sait ce qu’il veut et qui n’a pas besoin d’esbroufe pour convaincre. Une sorte de force tranquille qui se retrouve dans ses vers et qui lui permet de faire parfois le grand écart. « Le rugueux du jour se disperse / Les lumières crues s’adoucissent // Les corps s’apaisent » : voilà de la tendresse poétique, non ? Mais quelques pages plus tôt : « Lèche les dons sur sa peau // Le suc qui transpire dans ses reins / À la jouissance retenue / Cède aux tétons les lèvres et la salive // Monomane érectile ». Alors, tendre ou obsédé ? Lyrique ou rentre-dedans ? Un peu des deux, mais tout de même plus enclin à cogner, le poète a le dandysme pressant, pourrait-on dire. Il ne cache pas son dégoût de la société de la consommation exacerbée et portée au pinacle, lui crache à la gueule (« Le ciel est une déchirure / Un empyrée de menteurs »), la vilipende avec verve (« les aventuriers indigents sont fixés sur des fadaises en 3D »), se bat contre la mort « à mains nues rouges ». Mais il se réfugie aussi dans l’intime, l’amour, se blottit dans une armoire qui lui « ferait un manteau / Une peau ». L’Affolement des courbes, c’est ce va-et-vient entre dégoût et lassitude devant le monde qui lui fait balancer les vers les plus violents et les plus doux. Et c’est sacrément agréable à lire, parce que c’est sacrément bien écrit.
Sauvage, la poésie de Marc Tison l’est certainement. Je ne dirais pas à l’opposé de l’homme lui-même, car il est tout de même rock’n’roll, Marc, mais enfin il a aussi ce charme posé de celui qui sait ce qu’il veut et qui n’a pas besoin d’esbroufe pour convaincre. Une sorte de force tranquille qui se retrouve dans ses vers et qui lui permet de faire parfois le grand écart. « Le rugueux du jour se disperse / Les lumières crues s’adoucissent // Les corps s’apaisent » : voilà de la tendresse poétique, non ? Mais quelques pages plus tôt : « Lèche les dons sur sa peau // Le suc qui transpire dans ses reins / À la jouissance retenue / Cède aux tétons les lèvres et la salive // Monomane érectile ». Alors, tendre ou obsédé ? Lyrique ou rentre-dedans ? Un peu des deux, mais tout de même plus enclin à cogner, le poète a le dandysme pressant, pourrait-on dire. Il ne cache pas son dégoût de la société de la consommation exacerbée et portée au pinacle, lui crache à la gueule (« Le ciel est une déchirure / Un empyrée de menteurs »), la vilipende avec verve (« les aventuriers indigents sont fixés sur des fadaises en 3D »), se bat contre la mort « à mains nues rouges ». Mais il se réfugie aussi dans l’intime, l’amour, se blottit dans une armoire qui lui « ferait un manteau / Une peau ». L’Affolement des courbes, c’est ce va-et-vient entre dégoût et lassitude devant le monde qui lui fait balancer les vers les plus violents et les plus doux. Et c’est sacrément agréable à lire, parce que c’est sacrément bien écrit. « Écrire le chemin // Voilà à quoi se résume toute une vie / jusqu’au bout / vers le noir le plus absolu / le noir jamais assez noir celui avec lequel on peint / comme on écrit comme on marche » : et Gilbert Vautrin de reprendre la route à travers forêts, semant sur son passage des vers plutôt que des cailloux, collectionnant les impressions qu’il couchera ensuite sur le papier de ce long poème anthracite où la joie du chemin se mêle à la mélancolie qui convoque les grands aînés. Dans les sous-bois, le poète se nourrit de réminiscences de Tranströmer, de notes de Franz Schubert, de délires créatifs d’Artaud ; il passe en revue les illustres suicidés aussi, Janis Joplin, Jean Eustache, Sylvia Plath, Thierry Metz, « ils sont tous là dans [sa] tête ». Il n’y a rien de glauque cependant dans ce carnet. Tout juste s’agit-il de « sans cesse poursuivre le travail noir », un travail de mémoire autant que de lumière à chercher dans l’ombre. La nature est bien croisée sous la forme de ses incarnations animales ou végétales, il y a bien dans les vers de Gilbert du houx, un geai, des corbeaux (noirs, évidemment) ; mais tout se passe comme si celle-ci était un déclencheur. Les yeux du poète se posent sur les choses matérielles et son esprit vagabonde dans des sphères plus abstraites. Là où, lentement, se consume l’existence pour retourner au noir originel. Sans pathos, parce que tout ça est inexorable, et Gilbert l’a compris, qui offre ce texte autant en avertissement qu’en célébration de l’instant, car sait-on ce qui arrivera dans quelques minutes même ? Le chemin comme inspiration, il avoue sans ambages : « alors oui pour moi marcher est un état de poésie ».
« Écrire le chemin // Voilà à quoi se résume toute une vie / jusqu’au bout / vers le noir le plus absolu / le noir jamais assez noir celui avec lequel on peint / comme on écrit comme on marche » : et Gilbert Vautrin de reprendre la route à travers forêts, semant sur son passage des vers plutôt que des cailloux, collectionnant les impressions qu’il couchera ensuite sur le papier de ce long poème anthracite où la joie du chemin se mêle à la mélancolie qui convoque les grands aînés. Dans les sous-bois, le poète se nourrit de réminiscences de Tranströmer, de notes de Franz Schubert, de délires créatifs d’Artaud ; il passe en revue les illustres suicidés aussi, Janis Joplin, Jean Eustache, Sylvia Plath, Thierry Metz, « ils sont tous là dans [sa] tête ». Il n’y a rien de glauque cependant dans ce carnet. Tout juste s’agit-il de « sans cesse poursuivre le travail noir », un travail de mémoire autant que de lumière à chercher dans l’ombre. La nature est bien croisée sous la forme de ses incarnations animales ou végétales, il y a bien dans les vers de Gilbert du houx, un geai, des corbeaux (noirs, évidemment) ; mais tout se passe comme si celle-ci était un déclencheur. Les yeux du poète se posent sur les choses matérielles et son esprit vagabonde dans des sphères plus abstraites. Là où, lentement, se consume l’existence pour retourner au noir originel. Sans pathos, parce que tout ça est inexorable, et Gilbert l’a compris, qui offre ce texte autant en avertissement qu’en célébration de l’instant, car sait-on ce qui arrivera dans quelques minutes même ? Le chemin comme inspiration, il avoue sans ambages : « alors oui pour moi marcher est un état de poésie ». Oui, Miguel Ángel Real a écrit une note de lecture sur un de mes livres et en a traduit quelques poèmes en espagnol pour une revue en ligne, mais les chroniques-minute de ce site sont obstinément libres. Même si ça me fait plaisir d’évoquer le travail de Miguel, Comme un dé rond est un recueil hautement recommandable et figure ici à ce titre. D’ailleurs, tiens, ce titre ? Intéressant pour deux raisons au moins : son choix et sa traduction. Côté choix, puisque ce dé rond est oculaire (« Mes yeux souffrent comme un dé rond / dépourvu d’arêtes et de hasard ») et pose un regard interrogateur sur le labyrinthe de l’existence, il induit en erreur en quelque sorte. Ce recueil évoque en effet la mer, avec un vocabulaire ad hoc (« stridence des brisants : / ambre, vermillon et de blancs / oursins desséchés et cette vague »). On y fait naufrage, on s’y ressource, on la contemple, on y navigue avec « le vertige du mousse lors de son premier voyage ». Mais ce contraste entre titre et contenu est évidemment voulu : l’essentiel est le regard qu’on porte, qu’il soit sur une vaste étendue d’eau ou de sable. Côté traduction, comme le livre est en version espagnole et française, on ne peut s’empêcher de noter que ce dé rond dans la version originelle était « dados redondos », des dés ronds. Connaissant la méticulosité du poète dans ses traductions (ici secondé par Florence Real), on se doute qu’il y a une raison. Euphonie ? sens ? allitération acceptable dans une langue et pas dans l’autre ? Et l’on se prend à pousser les comparaisons pour mieux se plonger dans les abysses poétiques. Puis on apprend que la traversée n’est que partielle : ce recueil contient en fait des extraits du livre complet, à paraître au Mexique. Tant mieux, car on embarquerait bien plus longuement.
Oui, Miguel Ángel Real a écrit une note de lecture sur un de mes livres et en a traduit quelques poèmes en espagnol pour une revue en ligne, mais les chroniques-minute de ce site sont obstinément libres. Même si ça me fait plaisir d’évoquer le travail de Miguel, Comme un dé rond est un recueil hautement recommandable et figure ici à ce titre. D’ailleurs, tiens, ce titre ? Intéressant pour deux raisons au moins : son choix et sa traduction. Côté choix, puisque ce dé rond est oculaire (« Mes yeux souffrent comme un dé rond / dépourvu d’arêtes et de hasard ») et pose un regard interrogateur sur le labyrinthe de l’existence, il induit en erreur en quelque sorte. Ce recueil évoque en effet la mer, avec un vocabulaire ad hoc (« stridence des brisants : / ambre, vermillon et de blancs / oursins desséchés et cette vague »). On y fait naufrage, on s’y ressource, on la contemple, on y navigue avec « le vertige du mousse lors de son premier voyage ». Mais ce contraste entre titre et contenu est évidemment voulu : l’essentiel est le regard qu’on porte, qu’il soit sur une vaste étendue d’eau ou de sable. Côté traduction, comme le livre est en version espagnole et française, on ne peut s’empêcher de noter que ce dé rond dans la version originelle était « dados redondos », des dés ronds. Connaissant la méticulosité du poète dans ses traductions (ici secondé par Florence Real), on se doute qu’il y a une raison. Euphonie ? sens ? allitération acceptable dans une langue et pas dans l’autre ? Et l’on se prend à pousser les comparaisons pour mieux se plonger dans les abysses poétiques. Puis on apprend que la traversée n’est que partielle : ce recueil contient en fait des extraits du livre complet, à paraître au Mexique. Tant mieux, car on embarquerait bien plus longuement. « Il ne faudra pas bien longtemps / Avant que vous compreniez / La nature de ce recueil // C’est si enfantin / J’agis par faiblesse » : ce poème intitulé « Aveu », à la page 22, dévoile la mécanique huilée de l’art poétique de Xavier Frandon pour ce recueil. Un livre où la lumière vient de l’enfance, celle de ses filles qu’il regarde avec émerveillement et déjà nostalgie, se projetant dans la vieillesse avec elles alors qu’elles sont à peine sorties du berceau. « Comme je serai heureux de voir courir deux petits lapins », nous confie-t-il aussi en raccourcissant les années jusqu’à devenir « évincé par le ratatinage ». Enchantement du quotidien qui transporte dans un cocon de douceur. Avec des mots simples, dans une forme versifiée qui offre quelques rimes telles des fleurs écloses, ou bien des sonnets en salutaire contrainte de longueur, Xavier écrit des poèmes comme il discourrait, ne travaille pas au corps les métaphores, laisse couler les mots. Il parle de la vie beaucoup, de la nostalgie un peu ; beaucoup moins que dans ses précédents ouvrages, en tout cas. Ici, tout est baigné de clarté amoureuse, tout resplendit d’optimisme. Bien sûr, quelques ombres passent. Comment pourraient-elles être ignorées, puisqu’on évoque là deux adorables petites filles – doudou lapin en couverture est bien là pour le rappeler – et que s’inquiéter pour leur avenir dans le monde actuel est après tout signe de grande intelligence. Mais rien n’obscurcit l’empathie modeste et sincère de ce recueil. Et lorsque Xavier écrit « Tiens, je te fais un cadeau / C’est rien / C’est mon cœur vivant », on sait que ce n’est pas un simple mot d’enfant, mais un programme de vie. Un programme de poésie aussi, car les deux se confondent ici. C’est doux, sensible, pas guimauve, pas bravache. Une poésie qui fait sourire d’aise sans sortir la grosse artillerie. Qui fait du bien, quoi : mission accomplie.
« Il ne faudra pas bien longtemps / Avant que vous compreniez / La nature de ce recueil // C’est si enfantin / J’agis par faiblesse » : ce poème intitulé « Aveu », à la page 22, dévoile la mécanique huilée de l’art poétique de Xavier Frandon pour ce recueil. Un livre où la lumière vient de l’enfance, celle de ses filles qu’il regarde avec émerveillement et déjà nostalgie, se projetant dans la vieillesse avec elles alors qu’elles sont à peine sorties du berceau. « Comme je serai heureux de voir courir deux petits lapins », nous confie-t-il aussi en raccourcissant les années jusqu’à devenir « évincé par le ratatinage ». Enchantement du quotidien qui transporte dans un cocon de douceur. Avec des mots simples, dans une forme versifiée qui offre quelques rimes telles des fleurs écloses, ou bien des sonnets en salutaire contrainte de longueur, Xavier écrit des poèmes comme il discourrait, ne travaille pas au corps les métaphores, laisse couler les mots. Il parle de la vie beaucoup, de la nostalgie un peu ; beaucoup moins que dans ses précédents ouvrages, en tout cas. Ici, tout est baigné de clarté amoureuse, tout resplendit d’optimisme. Bien sûr, quelques ombres passent. Comment pourraient-elles être ignorées, puisqu’on évoque là deux adorables petites filles – doudou lapin en couverture est bien là pour le rappeler – et que s’inquiéter pour leur avenir dans le monde actuel est après tout signe de grande intelligence. Mais rien n’obscurcit l’empathie modeste et sincère de ce recueil. Et lorsque Xavier écrit « Tiens, je te fais un cadeau / C’est rien / C’est mon cœur vivant », on sait que ce n’est pas un simple mot d’enfant, mais un programme de vie. Un programme de poésie aussi, car les deux se confondent ici. C’est doux, sensible, pas guimauve, pas bravache. Une poésie qui fait sourire d’aise sans sortir la grosse artillerie. Qui fait du bien, quoi : mission accomplie.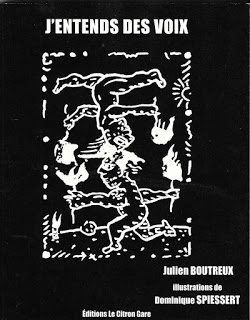 Il est déroutant, Julien Boutreux. Capable de fustiger dans ses poèmes les « images laborieuses / qui si souvent barbouillent / la poésie fumeuse » ou de vénérer Jude Stéfan pour ses nouvelles au point de l’entendre dans sa tête sans l’avoir rencontré — mais pas pour ses poèmes « nauséeux ». Capable de s’attendrir cependant lorsqu’il parle à Pierre de Ronsard, malgré le « précipice / entre [leurs] arts poétiques » ou de parler doucement aux gens pour les endormir dans une des professions imaginaires de « J’ai un métier vachement cool », qui précède la partie « J’entends des voix » dans ce recueil. C’est ce franc-parler, ces jugements de valeur parfois péremptoires combinés à cette admiration sincère des autres quand ils lui plaisent qu’on aime dans sa poésie et qu’on retrouve ici. Pas étonnant, d’ailleurs, que J’entends des voix sorte au Citron Gare, maison animée par Patrice Maltaverne : il y a une proximité de goût chez ces deux-là qui fait que tôt ou tard, un opus de Julien devait paraître chez Patrice. Voilà qui est fait, et bien fait : les illustrations de Dominique Spiessert sont en parfait accord avec une poésie vive, qui ne s’embarrasse pas de métaphores éculées et qui érige les strophes cash et sans chichis (autre proximité évidemment pour ce recueil : Heptanes Fraxion) en obligation contractuelle. « Toute la journée j’invente des phrases », nous dit encore le poète dans un des métiers cool qu’il nous présente, et il s’agit exactement de ça. Sur un canevas de départ simple, qu’il rencontre Sigmund Freud, Jésus-Christ, Lucifer ou Hildegarde de Bingen, qu’il « monte à la place du passager », « cherche des questions » ou voie « des formes changeantes / dans les marbrures des carreaux de [sa] salle de bain » comme occupation professionnelle, Julien tresse ses vers avec beaucoup de verve et d’à-propos. Le petit livre de 90 pages est vif, rythmé et utilise une large palette de genres d’humour, du noir de noir à l’ironie la plus cynique. La réunion de ces poèmes, dont certains ont paru dans Traction-brabant et Le Cafard hérétique (et, si je ne me trompe pas, sur l’éphémère profil Facebook de l’auteur, qui va et vient sur le réseau social au gré de ses envies), est donc une belle idée.
Il est déroutant, Julien Boutreux. Capable de fustiger dans ses poèmes les « images laborieuses / qui si souvent barbouillent / la poésie fumeuse » ou de vénérer Jude Stéfan pour ses nouvelles au point de l’entendre dans sa tête sans l’avoir rencontré — mais pas pour ses poèmes « nauséeux ». Capable de s’attendrir cependant lorsqu’il parle à Pierre de Ronsard, malgré le « précipice / entre [leurs] arts poétiques » ou de parler doucement aux gens pour les endormir dans une des professions imaginaires de « J’ai un métier vachement cool », qui précède la partie « J’entends des voix » dans ce recueil. C’est ce franc-parler, ces jugements de valeur parfois péremptoires combinés à cette admiration sincère des autres quand ils lui plaisent qu’on aime dans sa poésie et qu’on retrouve ici. Pas étonnant, d’ailleurs, que J’entends des voix sorte au Citron Gare, maison animée par Patrice Maltaverne : il y a une proximité de goût chez ces deux-là qui fait que tôt ou tard, un opus de Julien devait paraître chez Patrice. Voilà qui est fait, et bien fait : les illustrations de Dominique Spiessert sont en parfait accord avec une poésie vive, qui ne s’embarrasse pas de métaphores éculées et qui érige les strophes cash et sans chichis (autre proximité évidemment pour ce recueil : Heptanes Fraxion) en obligation contractuelle. « Toute la journée j’invente des phrases », nous dit encore le poète dans un des métiers cool qu’il nous présente, et il s’agit exactement de ça. Sur un canevas de départ simple, qu’il rencontre Sigmund Freud, Jésus-Christ, Lucifer ou Hildegarde de Bingen, qu’il « monte à la place du passager », « cherche des questions » ou voie « des formes changeantes / dans les marbrures des carreaux de [sa] salle de bain » comme occupation professionnelle, Julien tresse ses vers avec beaucoup de verve et d’à-propos. Le petit livre de 90 pages est vif, rythmé et utilise une large palette de genres d’humour, du noir de noir à l’ironie la plus cynique. La réunion de ces poèmes, dont certains ont paru dans Traction-brabant et Le Cafard hérétique (et, si je ne me trompe pas, sur l’éphémère profil Facebook de l’auteur, qui va et vient sur le réseau social au gré de ses envies), est donc une belle idée.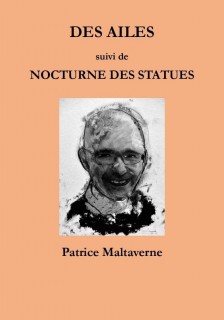 Dire que Dominique Laffin, morte à 33 ans en 1985, est une obsession pour Patrice Maltaverne n’est peut-être pas loin de la vérité : chacun transporte ses obsessions depuis l’enfance et l’adolescence, et si le « cerveau d’adulte » de Patrice est « soumis à toutes sortes de pressions », il n’a pas oublié la silhouette repérée dans les salles obscures à l’époque. D’ailleurs, celles et ceux qui lisent Traction-brabant se souviendront que l’actrice à la carrière fulgurante a déjà eu les honneurs des pages centrales du poézine par le taulier lui-même. De ces souvenirs et de ces fantasmes, le poète compose avec Des ailes un long texte, un thrène ou un tombeau, comme on voudra, qui étire ses vers comme un chant langoureux. Mais « c’est idiot de croire qu’une femme disparue au dernier siècle / pourrait arranger d’un sourire les vilenies de la vie ordinaire », et la nostalgie rejoint, comme souvent chez Patrice, la critique acerbe d’une société ou, en poète, il est difficile de trouver sa place. Avec, comme toujours aussi, des jeux de mots dosés de manière savante : « quand elle est morte je n’étais pas au courant / sauf que le courant est bien passé avec une morte ». Heureuse contrainte formelle, les vers de dix mots (ceux joints par des apostrophes comptent pour un seul) et sans ponctuation aèrent un poème qui serait sinon trop ramassé ; ils permettent de plus des enjambements qui confèrent un rythme unifié à l’ensemble (« je ne me suis pas rendu compte trop content d’être / un homme voulant parler à une femme dans une autre / langue qui fait pépier les oiseaux dressés sur / leurs branches pour des âmes carnivores ne pensant qu’à ça »). Souvenirs et fantasmes, présent et passé se mêlent dans cet émouvant hommage. Nocturne des statues, qui suit, reprend les mêmes thèmes et en développe l’aspect paysager urbain avec la contrainte de deux quatrains et un quintil par page, certains mots répétés selon un schéma prédéterminé, faisant du tout une plongée poétique dans un celluloïd rêvé sur le fauteuil confortable d’une salle de quartier, si on en trouve encore.
Dire que Dominique Laffin, morte à 33 ans en 1985, est une obsession pour Patrice Maltaverne n’est peut-être pas loin de la vérité : chacun transporte ses obsessions depuis l’enfance et l’adolescence, et si le « cerveau d’adulte » de Patrice est « soumis à toutes sortes de pressions », il n’a pas oublié la silhouette repérée dans les salles obscures à l’époque. D’ailleurs, celles et ceux qui lisent Traction-brabant se souviendront que l’actrice à la carrière fulgurante a déjà eu les honneurs des pages centrales du poézine par le taulier lui-même. De ces souvenirs et de ces fantasmes, le poète compose avec Des ailes un long texte, un thrène ou un tombeau, comme on voudra, qui étire ses vers comme un chant langoureux. Mais « c’est idiot de croire qu’une femme disparue au dernier siècle / pourrait arranger d’un sourire les vilenies de la vie ordinaire », et la nostalgie rejoint, comme souvent chez Patrice, la critique acerbe d’une société ou, en poète, il est difficile de trouver sa place. Avec, comme toujours aussi, des jeux de mots dosés de manière savante : « quand elle est morte je n’étais pas au courant / sauf que le courant est bien passé avec une morte ». Heureuse contrainte formelle, les vers de dix mots (ceux joints par des apostrophes comptent pour un seul) et sans ponctuation aèrent un poème qui serait sinon trop ramassé ; ils permettent de plus des enjambements qui confèrent un rythme unifié à l’ensemble (« je ne me suis pas rendu compte trop content d’être / un homme voulant parler à une femme dans une autre / langue qui fait pépier les oiseaux dressés sur / leurs branches pour des âmes carnivores ne pensant qu’à ça »). Souvenirs et fantasmes, présent et passé se mêlent dans cet émouvant hommage. Nocturne des statues, qui suit, reprend les mêmes thèmes et en développe l’aspect paysager urbain avec la contrainte de deux quatrains et un quintil par page, certains mots répétés selon un schéma prédéterminé, faisant du tout une plongée poétique dans un celluloïd rêvé sur le fauteuil confortable d’une salle de quartier, si on en trouve encore. Fidèle à
Fidèle à